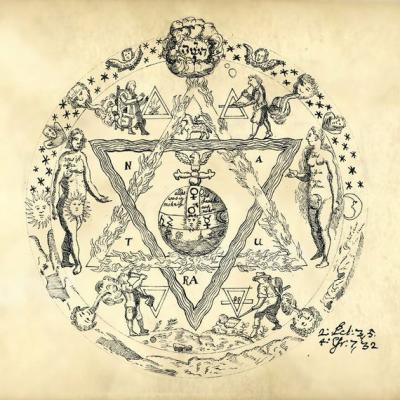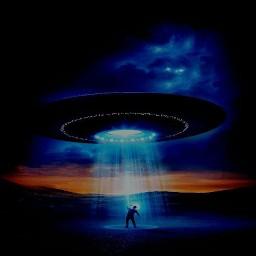Mystères 17

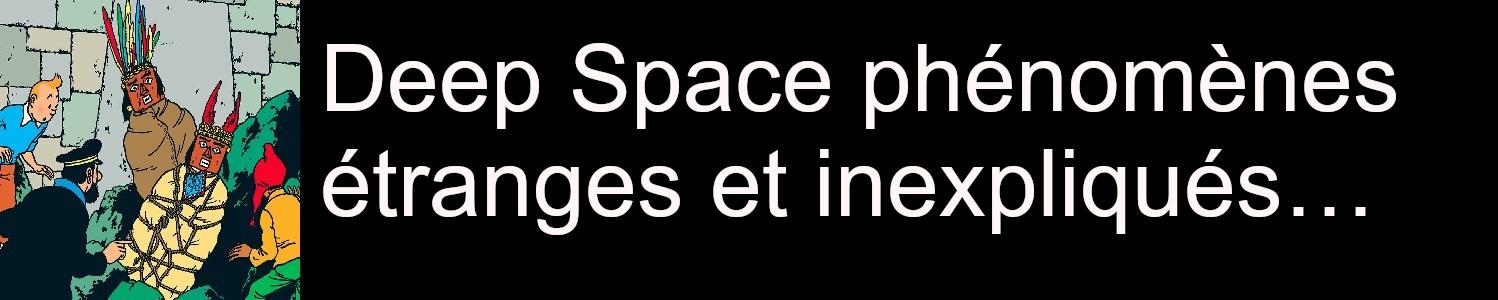
Un code caché dans des peintures préhistoriques décrypté par un amateur
 Des centaines de peintures préhistoriques retrouvées dans des grottes arborent ces petits traits et points.
Des centaines de peintures préhistoriques retrouvées dans des grottes arborent ces petits traits et points.
Alors que Ben Bacon, un conservateur de meubles de Londres, parcourait des galeries de peintures préhistoriques sur Internet, une idée lui est venue.
Traits
Et si les petits traits et points figurant sur plusieurs centaines d'entre elles étaient des marqueurs de temps ?
Théorie
Dans un article, HistoryNet évoque la théorie de cet amateur passionné, qui a conduit à une publication dans le Journal archéologique de Cambridge. Fasciné par ces œuvres réalisées, il y a 15.000 à 40.000 ans dans des grottes situées en Europe.
Ben Bacon
Ben Bacon avait fini par prendre conscience de la présence d'un certain nombre de motifs récurrents.
Lignes
À côté des animaux dessinés sur les parois, on peut régulièrement trouver des petites lignes et des petits points, que le passionné décrit comme « les premières écritures connues dans l'histoire de l'Homo sapiens ».
Détail
Un détail a particulièrement marqué Ben Bacon : il n'y en avait jamais plus de treize. Lui est alors venue une idée : ces symboles discrets pourraient avoir fait office de marqueurs temporels, se basant peut-être sur un calendrier lunaire.
Nuit
« Une nuit, a-t-il raconté à Vice, j'étais sur Internet en train de regarder ces peintures datant du Paléolithique sans y prêter vraiment attention » .
Nombre
« Lorsque j'ai remarqué, vraiment par hasard, que plusieurs animaux représentés avaient un nombre qui semblait leur être associé » .
Hypothèse
Il a partager son hypothèse avec des archéologues de l'université de Durham (nord de l'Angleterre) et de l'University College de Londres, pour qu'ils l'aident à confirmer cette théorie.
Découverte
Lors de la découverte des grottes il y a plus de 150 ans, les archéologues avaient d'abord pensé que les symboles « servaient à compter le nombre d'animaux aperçus ou tués par ces artistes préhistoriques », nous apprend Vice.
Chercheurs
Pour les chercheurs, la théorie du calendrier lunaire formulée par Ben Bacon « colle au fait que la connaissance des périodes de migration, d'accouplement ou de mise-bas des animaux du Paléolithique était un sujet central, puisque toute l'organisation humaine en dépendait ».
Calendrier
Un tel calendrier ne fonctionne d'ailleurs pas sur un principe annuel, mais bien sur une comptabilisation par saison. Question de survie.
Pourquoi y a-t-il des plages de galets et d'autres de sable ?
 Si l'on se chamaille aujourd'hui pour savoir qui du sable ou des galets fait les meilleurs plages, il se pourrait de toute manière qu'un jour, notre choix soit réduit.
Si l'on se chamaille aujourd'hui pour savoir qui du sable ou des galets fait les meilleurs plages, il se pourrait de toute manière qu'un jour, notre choix soit réduit.
Si pour beaucoup, la plage est avant tout synonyme de sable fin, il n'en est pas ainsi sur de nombreux bords de mer. D'Etretat à Dieppe, en passant par Nice ou Collioure, les plages de galets sont présentes un peu partout en France.
Sédiments
C'est avant tout une accumulation de sédiments. C'est un gigantesque dépôt de roches en tous genres, où se mêlent par-ci par-là des coquillages cassés, dont les morceaux se sont éparpillés avec le temps.
D'où viennent ces sédiments ?
D'un peu partout. Des fonds marins aux rivières, sans oublier les falaises et récifs sans cesse heurtés par les vagues.
Entre un morceau de falaise et un grain de sable fin, il y a une petite différence ! Une marge due à l'érosion.
La pluie, le vent, et les vagues érodent, dégradent avec le temps, tout ce qu'ils trouvent sur leur passage, jusqu'à transformer des blocs massifs en grains minuscules : les fameux sédiments.
Pourquoi existe-t-il des plages de galets ou de sable, me direz-vous ?
Étant donné que la plage est essentiellement le résultat de l'érosion des roches environnantes, la composition de ces dernières influences directement le type de plage auquel on aura affaire.
Si l'on part en vacances dans le Sud-Ouest par exemple, on s'apercevra que la région est particulièrement riche en grès.
Formé de grains agglomérés par un ciment naturel, le grès s'effrite avec l'érosion et la roche finit par se diviser en d'infimes morceaux qui viennent se déposer sur la plage : une plage qui sera donc faite de sable fin.
 L’empilement de galets sur le littoral, en apparence inoffensif, supprime les micro-habitats » et empêche « l’absorption de l’énergie des vagues »,
L’empilement de galets sur le littoral, en apparence inoffensif, supprime les micro-habitats » et empêche « l’absorption de l’énergie des vagues »,
Il en va de même pour le granite, qui se transforme en sable, notamment sur certains endroits de la côte en Bretagne.
Un sable un peu moins fin certes, mais un sable tout de même. Si, au contraire, vous prenez la direction de la Normandie, c'est à la craie que vous aurez affaire.
Prenez Etretat : ses magnifiques falaises blanches sont faites de craie, et ses immenses arches naturelles sont le fruit de l'érosion par la mer.
Le vent et la pluie, la craie se dissout et libère des galets de silex qu'elle abritait. Les galets, arrondis par les frottements, viennent ensuite se déposer sur le rivage, poussés par les courants marins.
Le courant est également un facteur influençant directement la nature d'une plage. Si cette dernière est exposée aux vagues et aux va-et-vient incessants de l'eau, les sédiments les plus fins se voient souvent emportés.
Ils laissent derrière eux les gaillards les plus lourds, les galets, bien décidés à ne plus se bouger la roche. Là où les eaux sont en revanche calmes, le sable se maintient. Et quand elles stagnent, complètement abritées de tout courant.
Plages en voie de disparition ?
Il se pourrait qu'un jour, notre choix soit réduit. Avec le changement climatique, les littoraux sableux sont en effet plus que jamais menacés.
Ces derniers, qui couvrent près d'un tiers du linéaire côtier mondial, s'érodent à vitesse grand V avec l'augmentation du niveau moyen de la mer.
Une tendance qui risque de s'aggraver tout au long du siècle. Pas au point de faire disparaître entièrement les plages de sable, mais en réduisant considérablement leur nombre.
Le phénomène est notamment accentué par la demande constante de sable. Particulièrement convoité pour les constructions, il est extrait en quantité toujours plus importante.
Pourtant, il arrive de moins en moins dans les mers, freiné par les barrages sur sa route. Les plages, encore un de ces trucs que l'on aura réussi à foutre en l'air .
Une découverte lors d'une fouille place Hippolyte-Renoux à Clermont-Ferrand
 Au total, ce sont 52 structures funéraires qui ont été découvertes.
Au total, ce sont 52 structures funéraires qui ont été découvertes.
Une découverte inédite lors d'une fouille place Hippolyte-Renoux à Clermont-Ferrand Au total, ce sont 52 structures funéraires qui ont été découvertes.
Sépultures
Une fouille de l'Inrap, de l'ancienne église Saint-Genès à Clermont-Ferrand, a permis la mise au jour de nombreuses sépultures.
Vestiges
Entre chapelets du Moyen Âge et prothèse dentaire de l’époque contemporaine, du 2 mai au 16 juin 2023, une équipe d’archéologues de l’Inrap a fouillé la partie sud de la place Hippolyte-Renoux à Clermont-Ferrand, dans le cadre du vaste projet Inspire. 189 m2 qui ont permis de mettre au jour des vestiges anciens.
Structures
Au total, ce sont 52 structures funéraires qui ont été découvertes dans la moitié ouest de la fouille. Parmi les ossements retrouvés, certaines sépultures contenaient des objets tels que des chapelets et des pendentifs cruciformes. Plus surprenant, dans l'une d'entre elles, deux prothèses dentaires inédites du XVIIIe siècle.
Fouilles
Lors des fouilles, deux sépultures d'époque moderne ont été mises au jour dans l'emprise de l'église Saint-Genès. L’une d’entre elles renfermait le squelette complet d’une jeune femme. L’étude des restes dentaires a permis la découverte de deux prothèses.
Dents
Ses dents de substitution se composent d’un pivot métallique à introduire dans la dent préalablement percée et d’une couronne artificielle dont le matériau reste à déterminer.
Procédé
Un tel procédé est décrit par un chirurgien-dentiste du XVIIIe siècle, Pierre Fauchard, dans son "Traité des dents" paru en 1746, et implique l’intervention d’un praticien ayant de solides connaissances en anatomie bucco-dentaire. Grâce à cette découverte, on imagine aisément le statut privilégié de la jeune défunte.
Dans l’inconnu : La grotte aux ossements
 Le paléoanthropologue Lee Berger dans le système de grottes Rising Star du "Berceau de l'humanité", au nord-ouest de Johannesburg, le 11 mai 2023.
Le paléoanthropologue Lee Berger dans le système de grottes Rising Star du "Berceau de l'humanité", au nord-ouest de Johannesburg, le 11 mai 2023.
Le paléoanthropologue Lee Berger enquête avec son équipe sur le plus vieux cimetière du monde, qui n’est pas humain. Le site, connu sous le nom de Rising Star Cave, est situé dans le berceau de l’humanité en Afrique du Sud et contient les restes de plus de 15 individus ayant vécu il y a plus de 250 000 ans.
Lee Berger
L’équipe dirigée par Lee Berger a fait une grande découverte ; le plus ancien cimetière du monde et ce n'est pas un cimetière humain.
Créature
Cette ancienne créature au petit cerveau ressemblant à un singe pratiquait des rituels funéraires complexes, cela change tout ce que nous savons sur l'évolution des hominidés et les origines de la croyance.
Galeries
Dans des alcôves enfouies au bout d'un réseau d'étroites galeries, à une trentaine de mètres sous terre, de lointains cousins de l'homme à l'état de fossile ont été retrouvés dans des sépultures lors de fouilles entamées en 2018.
Explorateurs
Les explorateurs ont constaté que les tombes avaient été rebouchées avec la terre creusée au départ pour former les trous, preuve selon eux que les corps de ces pré-humains ont été volontairement enterrés.
Inhumations
"Il s'agit des inhumations les plus anciennes jamais enregistrées chez les hominidés, antérieures d'au moins 100.000 ans aux inhumations d'Homo sapiens".
 Le paléoanthropologue Lee Berger devant la principale entrée du système de grottes Rising Star du "Berceau de l'humanité", au nord-ouest de Johannesburg, le 11 mai 2023.
Le paléoanthropologue Lee Berger devant la principale entrée du système de grottes Rising Star du "Berceau de l'humanité", au nord-ouest de Johannesburg, le 11 mai 2023.
Fouilles
Les fouilles ont eu lieu sur le site paléontologique du "Berceau de l'humanité", classé au patrimoine mondial de l'Unesco et situé au nord-ouest de Johannesburg.
Découvertes
Les tombes les plus anciennes découvertes jusqu'ici, notamment au Proche-Orient et au Kenya, datent d'environ 100.000 ans avant notre ère et abritent des restes d'Homo sapiens.
Sépultures
Les sépultures sud-africaines datent de -200.000 à -300.000 ans. Elles contiennent des ossements d'Homo naledi (étoile en langue locale), petit hominidé d'environ 1,50 m de haut et au cerveau de la taille d'une orange.
Espèce
L'espèce, dont la découverte en 2013 par le paléoanthropologue américain Lee Berger avait déjà remis en cause les lectures linéaires de l'évolution de l'Humanité, reste encore un mystère pour les scientifiques.
Caractéristiques
Doté à la fois de caractéristiques de créatures vieilles de plusieurs millions d'années, comme une dentition primitive et des jambes de grimpeurs, Homo naledi est aussi doté de pieds semblables aux nôtres et de mains capables de manier des outils.
 Grottes Rising Star du "Berceau de l'humanité", au nord-ouest de Johannesburg, le 11 mai 2023.
Grottes Rising Star du "Berceau de l'humanité", au nord-ouest de Johannesburg, le 11 mai 2023.
Pratiques
"Ces découvertes montrent que les pratiques mortuaires n'étaient pas limitées à l'Homo sapiens ou à d'autres hominidés dotés d'un cerveau de grande taille", affirment les scientifiques.
Théorie
Cette théorie, qui va à l'encontre de l'idée communément acceptée que la conscience de la mort et les pratiques liées font l'humain, avait déjà été évoquée par Lee Berger lorsqu'il avait présenté Homo naledi au monde en 2015.
Hypothèse
L'hypothèse avait alors créé un tollé de nombreux spécialistes avaient mis en doute la rigueur scientifique de l'Américain médiatique, soutenu par National Geographic.
Scientifiques
"C'était trop pour les scientifiques à l'époque", commente Lee Berger, lors d'un entretien. Ils restent "convaincus que tout cela est lié à notre gros cerveau et que cela s'est produit très récemment, il y a moins de 100.000 ans", explique-t-il.
Symboles
"Nous sommes sur le point de dire au monde que ce n'est pas vrai", triomphe l'explorateur de 57 ans, qui va encore plus loin. Des symboles géométriques, soigneusement tracés à l'aide d'un outil pointu ou tranchant, ont été retrouvés sur les parois des tombes.
Carrés
Carrés, triangles et croix ont été, selon lui, intentionnellement laissés sur des surfaces lissées, probablement pour les rendre plus lisibles.
 Grottes Rising Star.
Grottes Rising Star.
Humains
"Cela signifierait que non seulement les humains ne sont pas les seuls à avoir développé des pratiques symboliques, mais qu'ils n'ont peut-être même pas inventé de tels comportements", avance Lee Berger.
Carol Ward
Anthropologue à l'Université du Missouri, estime que "ces résultats, s'ils étaient confirmés, auraient une importance considérable".
Résultats
"J'ai hâte d'apprendre comment la disposition des restes exclut d'autres explications possibles que l'enterrement intentionnel, et de voir les résultats une fois qu'ils auront été examinés par des pairs", a-t-elle déclaré.
Analyses
Des analyses plus approfondies doivent encore être menées. Mais déjà, l'équipe de Berger annonce qu'il va falloir "repenser toute une série d'hypothèses sur les hominidés et l'évolution humaine".
Chercheurs
Depuis longtemps, les chercheurs ont associé la capacité à maîtriser le feu, la gravure ou encore la peinture, à la puissance cérébrale de l'homme moderne, comme typiquement chez l'homme de Cro-Magnon.
Enterrement
"L'enterrement, la création de sens, et même l'art pourraient avoir une origine bien plus compliquée et non-humaine que nous ne le pensions", présage Agustín Fuentes, anthropologue à l'Université de Princeton et co-auteur des découvertes.
Exceptionnelle découverte à Aberlemno en Écosse d’une pierre sculptée de symboles pictes
 Pierre sculptée de symboles.
Pierre sculptée de symboles.
Une équipe d’archéologues de l’Université d’Aberdeen a fait l’étonnante découverte d’une pierre sculptée de symboles lors de recherches d’un ancien bâtiment picte.
Culture
Ce bloc témoigne de la culture des Pictes, une civilisation occupant une partie du territoire de l’Écosse actuelle, dont nous ne savons encore que peu de choses.
Équipe
Cette équipe de recherche, présente à Aberlemno en Écosse, passait en revue le sol de ce village connu pour abriter des trésors ancestraux du peuple picte en espérant y déceler une quelconque ruine ensevelie. Et surprise : elle y trouva une pierre gravée de la taille d’une hauteur d’homme datant de plus d’un millénaire.
Retrouvé
Il n’a été retrouvé en tout et pour tout que 200 artefacts comme celui-ci. Les Pictes, fédération de tribus, vécurent au nord et à l’est de l’Écosse actuelle à partir du IIIe siècle.
Écosse
Ils disparurent au milieu du IXe siècle, probablement dilués dans d’autres sociétés gaéliques lors de la création de l’Écosse médiévale.
Pierre
"La pierre a été retrouvée encastrée dans le dallage d’un immense édifice du XIe ou XIIe siècle. Le pavage comprenait des pierres pictes et des exemples d’art rupestre de l’âge de bronze".
Gordon Noble
"Ce qui est passionnant, c'est que le bâtiment des XIe et XIIe siècles semble avoir été construit directement au-dessus de couches remontant à la période picte", a déclaré le professeur Gordon Noble, dirigeant du projet, sur le site de l’Université d’Aberdeen.
Découverte
Découverte unique en son genre, selon les chercheurs, la pierre daterait du Ve ou VIe siècle. Plusieurs strates de symboles s’étalant sur plusieurs siècles s’y trouvent, a contrario des autres pierres existantes déterrées.
Singularité
Cette singularité est une aubaine pour permettre une étude plus approfondie de la civilisation picte et de ses mœurs, ainsi que de l’influence du christianisme au fil des âges.
Preuve
"La découverte de cette nouvelle pierre picte et la preuve que ce site a été occupée pendant une si longue période offriront de nouvelles perspectives sur cette période importante de l’histoire de l’Écosse".
Comprendre
Et nous aideront à mieux comprendre comment et pourquoi cette partie de l’Angus est devenue un paysage picte clé et, par la suite, une partie intégrante des royaumes d’Alba et d’Écosse", explique Gordon Noble.
Région
Il s’agit donc de l'une des plus remarquables découvertes de ces trois dernières décennies dans la région. La pierre a été envoyée au laboratoire de conservation grâce au soutien du service archéologique de l’Aberdeenshire. Elle sera ensuite conservée et exposée au public une fois les analyses de l’artefact abouties.
Questions
De nombreuses questions se posent encore sur cette période historique parsemée de zones d’ombre et des trésors encore enfouis restent à découvrir pour ces archéologues dans cette zone propice à compréhension de la culture picte.
Emblématique
Emblématique du passé de l’Écosse, ainsi que sur d’autres parties du territoire où d’importantes découvertes liées à différents moments de l’Histoire ont déjà eu lieu.
Découverte en Jordanie d’une des plus anciennes structures humaines au monde
 Dans le désert de Jibal al-Khashabiyeh, des archéologues ont mis au jour un site rituel vieux de 9.000 ans. © Jordanian Antiquities Authority/AFP.
Dans le désert de Jibal al-Khashabiyeh, des archéologues ont mis au jour un site rituel vieux de 9.000 ans. © Jordanian Antiquities Authority/AFP.
Des archéologues ont mis au jour en Jordanie un site vieux de 9 000 ans consacré aux cultes il pourrait s'agit de l'une des plus anciennes constructions humaines connues
Site
Le site vieux de 9.000 ans consacré à des rituels, et qui pourrait être une des plus anciennes structures humaines au monde.
Exhumé
Le site, qui date de l'âge de pierre, a été exhumé en 2021 dans le désert de Jibal al-Khashabiyeh, dans le sud-est de la Jordanie, selon un communiqué conjoint du département jordanien des Antiquités et du ministère jordanien des Antiquités.
Découvert
Il a été découvert par une équipe d'archéologues français et jordaniens, réunis au sein du Projet archéologique du Sud-est de Badia (SEBAP).
Rites
Utilisé pour les rites de chasseurs de gazelle, le site comprend notamment un autel et un modèle miniature d'un piège à gibier surnommé "cerf-volant du désert" en raison de sa forme.
Néolithique
A l'ère néolithique, les gazelles étaient rabattues par les chasseurs vers de grands murs en pierre qui les dirigeaient ensuite vers un enclos ou un trou où elles étaient abattues.
Structures
Des structures similaires, aux murs parfois longs de plusieurs kilomètres ont été découvertes en Arabie saoudite, en Syrie, mais aussi en Turquie et au Kazakhstan.
Spectaculaire
Celle découverte en Jordanie est "spectaculaire et inédite", ont affirmé les autorités jordaniennes dans leur communiqué, soulignant qu'il s'agissait de "la plus ancienne structure au monde construite à grande échelle connue jusqu'à présent."
Stèles
Le site comprend également deux stèles à silhouette humaine dont une haute de 1,12 mètres, mais aussi des silex, des statuettes représentant des animaux, et 150 fossiles marins placés d'une certaine manière.
Connaissance
Le SEBAP espère pouvoir approfondir sa connaissance des "premières sociétés pastorales et nomadiques, ainsi que l'évolution des stratégies" de chasse, d'après le communiqué.
Chasse
Ces "cerfs-volants du désert suggèrent des stratégies de chasse massive extrêmement sophistiquées, inattendues à une époque aussi ancienne", explique le communiqué. Le site servait certainement à "invoquer les forces surnaturelles pour des chasses fructueuses et des proies en abondance."
Véronique Vouland-Aneini
L'ambassadrice de la France en Jordanie, Véronique Vouland-Aneini, a salué une "réussite à la fois pour le monde scientifique et la Jordanie". Estimant que "cela nous donne un témoignage précieux de l'Histoire au Moyen-Orient, ses traditions et ses rituels".
Date de dernière mise à jour : 05/01/2024