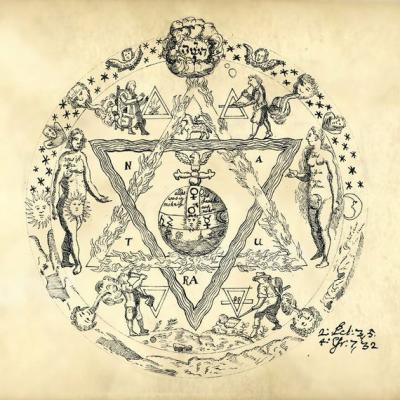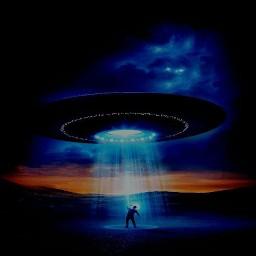Mystéres 18

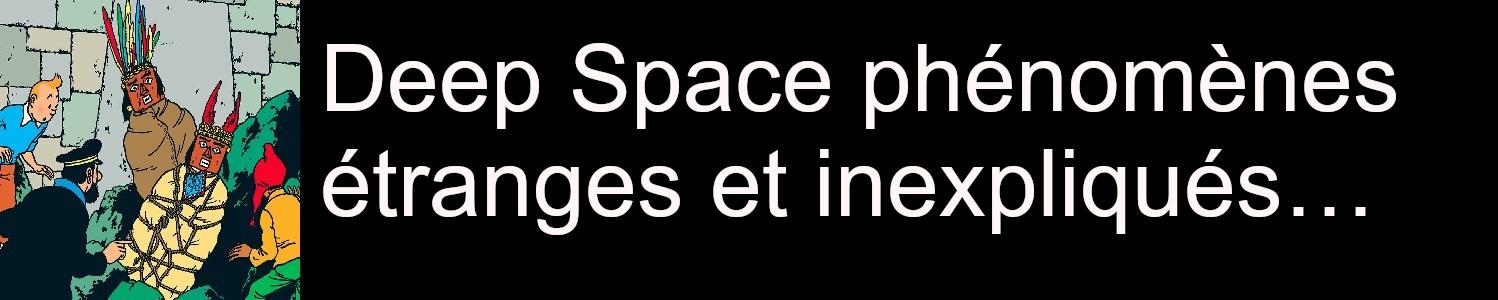
Depuis 300 ans de mystérieux objets à douze faces sont découverts
 Deux dodécaèdres et un icosaèdre. Rheinisches Landesmuseum Bonn. Les dodécaèdres proviennent de Bonn et Frechen-Bachem, l'icosaèdre d'Arloff.
Deux dodécaèdres et un icosaèdre. Rheinisches Landesmuseum Bonn. Les dodécaèdres proviennent de Bonn et Frechen-Bachem, l'icosaèdre d'Arloff.
En Angleterre, des archéologues amateurs ont découvert en 2023 un objet métallique, enfoui dans un champ proche du village de Norton Disney, dans le Lincolnshire, indique Vice. En réalité, il s'agit d'un dodécaèdre (une figure géométrique à douze faces) romain.
Formes
Généralement en bronze ou en pierre, ces petites formes datent du IIe au IVe siècle après J.-C. et chacune de leurs faces porte un trou circulaire en son centre. Depuis plus de 300 ans, les spécialistes en découvrent un peu partout en Europe.
Objets
Pourtant, personne n'arrive pas a comprendre à quoi servaient ces objets. Ils ne portent aucune trace de texte ni de chiffres qui pourrait fournir des indices sur leur utilisation.
Dodécaèdres
La plupart des dodécaèdres ont été dénichés dans l'ancienne Gaule, c'est-à-dire le territoire correspondant aujourd'hui au nord de l'Italie, à la France, la Belgique, l'Allemagne et au sud des Pays-Bas. La découverte de Norton Disney est la première dans cette région de l'Angleterre, les Midlands.
 Carte de L’Empire Romain au premier siècle après Jésus-Christ.
Carte de L’Empire Romain au premier siècle après Jésus-Christ.
Michael Guggenberger
Selon l'archéologue Michael Guggenberger, cette forme à douze faces a joué un rôle important dans les cultures grecques et romaines, pendant des siècles. « Le dodécaèdre pentagonal régulier est l'un des cinq solides de Platon, celui qui représente le cosmos, l'univers dans son ensemble », précise Vice.
Richard Parker
Richard Parker, secrétaire du groupe d'histoire et d'archéologie de Norton Disney, soupçonne que les dodécaèdres étaient utilisés pour des pratiques religieuses ou rituelles. Selon le média, les chercheurs ont avancé près de cinquante théories différentes concernant l'utilisation de ce polyèdre. Il pourrait s'agir d'une arme, d'un jouet, ou encore d'un bougeoir.
Matériaux
« D'après le nombre de pièces trouvées, la qualité des matériaux et le processus de fabrication coûteux, il est évident que ces dodécaèdres n'étaient ni des objets d'occasion que l'on pouvait acheter aux coins des rues, ni des objets extrêmement rares », détaille Michael Guggenberger.
Site
Richard Parker est optimiste et pense que le site de Norton Disney a beaucoup à offrir. Ce dernier regorge d'artefacts archéologiques qu'il reste à découvrir, et qui livreront sûrement de nouveaux éléments de réponses concernant les dodécaèdres.
États-Unis : un Français découvre un incroyable diamant
 Julien Navas a exprimé sa volonté de ne pas vendre sa pierre.
Julien Navas a exprimé sa volonté de ne pas vendre sa pierre.
Le jeudi 11 janvier 2024 en voyage aux États-Unis, un Français a découvert un diamant rare lors de sa visite du « Cratère des diamants », un parc situé dans l'Arkansas. Il s'agit de la huitième plus grosse pierre jamais retrouvée sur le site.
Pierre
Une pierre précieuse qui vaut plusieurs dizaines de milliers d'euros Julien Navas, 42 ans, a trouvé l'impensable lors de son séjour Outre-Atlantique : un diamant brun de 7,46 carats.
Français
De passage aux États-Unis pour assister au lancement de la fusée Vulcan Centaur, à Cap Canaveral, en Floride, ce Français originaire de Paris a fait cette découverte exceptionnelle lorsqu'il a décidé se rendre dans le célèbre « Cratère du Diamants » (Crater of Diamonds), un parc situé dans le sud du pays.
Creuser
« Je suis arrivé au parc vers 9 h et j'ai commencé à creuser, c'était très fatigant », raconte-t-il. Il s'agit du huitième plus gros diamant jamais découvert sur le site.
Julien Navas
Julien Navas a exprimé sa volonté de ne pas vendre sa pierre, souhaitant que celle-ci soit taillée en deux afin d'en confectionner deux bagues : une pour sa fiancée et une pour sa fille.
Exploitation
Le site du parc était autrefois une exploitation minière commerciale de diamants, mais en 1972, il a été transformé en parc d'État.
 Un visiteur français découvre un diamant de 7,46 carats au parc national Crater of Diamonds.
Un visiteur français découvre un diamant de 7,46 carats au parc national Crater of Diamonds.
Visiteurs
les visiteurs peuvent chercher des diamants dans une zone de champ de 37 acres (environ 15 hectares) qui contient une variété de roches, de minéraux et bien sûr, des diamants.
Parc
Le parc d’État Crater of Diamonds est le seul site au monde où, pour un petit droit d’entrée, chacun peut venir chercher des diamants et garder ses trouvailles.
Outils
Les visiteurs peuvent louer des outils tels que des pelles et des tamis, et ils sont autorisés à garder tout diamant, minéral ou pierre précieuse qu'ils trouvent.
Diamants
De nombreux visiteurs ont en effet découvert des diamants au fil des ans, ce qui a contribué à la réputation du parc. Cependant, la plupart des diamants trouvés sont relativement petits.
Activités
Le parc offre également d'autres activités récréatives, des sentiers de randonnée, des aires de pique-nique et un centre d'accueil où les visiteurs peuvent en apprendre davantage sur la géologie de la région et les techniques de recherche de diamants.
Le mystère de la grotte de Montérolier
 La grotte de Montérolier.
La grotte de Montérolier.
Été 1995, neuf personnes ont pénétré dans la grotte de Montérolier en Normandie, pour ne plus jamais en ressortir. Face aux expertises, les doutes planent toujours sur les circonstances de l'accident.
Galeries
Au premier jour de l'été 1995, neuf personnes, trois jeunes adolescents et six adultes, pénètrent dans un dédale de galeries creusées dans le sous-sol pour ne plus jamais en ressortir. À quelques minutes du village de Buchy, la grotte de Montérolier, est un lieu bien connu des gens du coin.
Site
Un site d'exploration pour les curieux et un terrain de jeu pour les enfants. Ce sont les Allemands qui, en toute hâte, à la fin de la guerre, ont construit cet immense complexe destiné à accueillir les bombes volantes destinées à détruire Londres.
Parcours
La grotte sert de parcours de jeu de piste ou de chasse au trésor à tous les enfants du pays. Gérard Duvivier, féru de spéléologie, propose ses services pour guider un groupe de sapeurs-pompiers arrivé sur les lieux.
Drame
Mais ni lui, ni le sapeur de Buchy Fabrice Pigny, ni le caporal-chef Bruno Poulain, le sergent Laurent Pannier, le capitaine-médecin Jean-Yves Soulard, tous trois de Rouen, n'en sortiront vivants. Ils entreront sans appareils respiratoires, certains se perdront, l'un d'eux trouvera les corps des enfants. Mais ils tomberont les uns après les autres.
Investigations
Les investigations ont soulevé plus de questions que de réponses. Face à des familles anéanties, la justice a toujours affirmé une intoxication au monoxyde de carbone, due à un feu allumé par les enfants. sans toutefois communiquer les dossiers médicaux.
Scepticisme
Le scepticisme des familles n'a jamais cessé d'exister, suite au témoignage effarant d'un survivant, le sapeur-pompier volontaire Dominique Petit. Ce dernier a toujours décrit un nuage gris ainsi qu'une odeur d'œuf pourri.
Analyses
En 1997, toutes les demandes de nouvelles analyses des familles sont rejetées. La justice prononce alors un non-lieu puis classe le dossier. "Ce sera le mur à chaque fois pour nous, témoigne José Lampérier, père de Pierre Lampérier, un des enfants qui ont perdu la vie".
 La grotte de Montérolier.
La grotte de Montérolier.
Demandes
"Toutes les demandes, y compris jusqu'en cassation, ce seront des refus. Tout le monde trouve ça troublant, mais devant vous, vous avez la justice. Votre feuille est blanche, mais on vous dit qu'elle est noire. Et vous avez intérêt à comprendre que votre feuille est noire, car de toute façon, elle est noire".
Cavité
Malgré la découverte d'une cavité inexplorée, 5 ans après le drame, le dossier judiciaire n'a jamais été rouvert. L'espace pourrait toujours contenir des déchets chimiques inflammables, de quoi attester les dires de Dominique Petit.
Secret
Le père d’une des victimes, tout comme la population, continue de croire qu’on a cherché à cacher un terrible secret, celui d’un gaz toxique qui aurait été stocké dans la grotte et qui expliquerait une telle hécatombe. D'autant que du cyanure a été retrouvé dans le sang de toutes les victimes.
Découverte
À cela, s'ajoute la découverte, dans les années 90, qu’il y avait non loin de là, en 1944, à Villers-Saint-Sépulcre, une usine franco-allemande de fabrication de Zyklon B, le gaz à base de cyanure utilisé dans les chambres à gaz. Même si cela ne prouve rien, cela permet de comprendre comment le contexte a alimenté le soupçon.
Élément
Autre élément, la décision, la nuit du drame, d’interrompre les secours pendant sept heures, le temps de faire ventiler les galeries.
Il existe une autre ville nommée Lyon aux États-Unis
 Lyon, Mississippi / États-Unis.
Lyon, Mississippi / États-Unis.
Bienvenue à Lyon, Mississippi, une bourgade nichée au cœur du comté de Coahoma et homonyme de notre capitale des Gaules. Une ville qui aurait même été nommée en référence à Lugdunum.
Mississippi
Au coeur de l'état du Mississippi, il est une petite bourgade dont le nom nous semble étrangement familier : Lyon. Parfaite, homonyme de notre capitale des Gaules, cette ville américaine offre néanmoins des panoramas radicalement différents.
Horizons
Des horizons désertiques baignés par le soleil du Sud-Américain. Mais Lyon, Mississippi, a une histoire qui lui est propre.
Fondée
Fondée en 1897, cette petite communauté d'à peine 288 habitants a vu ses jours de gloire avec une population de 446 âmes en 1990. Bien qu'elle soit entourée de mystère, une chose est sûre : Lyon, Mississippi, partage plus qu'un nom avec notre cité française.
Information
Selon une information, cette ville américaine aurait été baptisée en hommage à Lyon.
Voiture
À environ 1 h 30 en voiture de la vibrante Memphis, Lyon, Mississippi, dévoile son charme en toute modestie. Malgré son statut de petit village, elle a vu défiler des personnalités marquantes, contribuant à tisser la trame de son histoire.
Poète
Parmi elles, le poète et vétéran de guerre Lamar Fontaine, le légendaire chanteur de blues, le footballeur professionnel Charles Mitchell ou encore l'écrivain Lacy Banks ont laissé leur empreinte dans ce coin reculé du Mississippi.
Tennessee Williams
Mais c'est sans doute l'immense Tennessee Williams, l'un des dramaturges les plus influents du XXe siècle à qui l'on doit un tramway nommé Désir (1947), La Chatte sur un toit brûlant (1955) et Doux oiseau de jeunesse (1959), qui a conféré à Lyon, Mississippi, une notoriété particulière. Dans son poème "The Couple", il évoque un mystérieux duo errant à Lyon, un couple fantomatique perché sur un échafaudage de bois.
Vestiges de l’Égypte antique le long du Nil
 L'Égypte est une étrange réalité / Photo Colette Colognac.
L'Égypte est une étrange réalité / Photo Colette Colognac.
L'Égypte est une étrange réalité géographique. Tout s'y fait au contraire des autres pays, remarque Hérodote. C'est une longue oasis verdoyante d'une fertilité extraordinaire.
Aridité
Mais, hors de la plaine qui borde le fleuve, c'est un terrain d'une affreuse aridité, qui commence de manière si abrupte qu'on peut avoir un pied dans les cultures et l'autre dans le désert. Ailleurs, les inondations sont irrégulières et destructrices ; ici, elles sont étonnamment réglées et fécondantes.
Peuples
Les autres peuples doivent défendre leurs frontières. L'Égypte n'a à se garder qu'au nord-est, vers la péninsule du Sinaï et, encore, faut-il pour l'attaquer sérieusement des empires organisés, parce qu'il est nécessaire de franchir un désert inhospitalier pour arriver à l'eau et aux cultures.
Ailleurs
Partout ailleurs, des solitudes sableuses et mortelles la protègent. Elle n'a été conquise qu'une fois par le sud, au VIIIe siècle.
Particularité
Le lit du fleuve présente aussi une curieuse particularité. Tant qu'il descend du sud au nord entre les montagnes arabiques à l'est et les hauteurs libyques à l'ouest, la vallée est unique, relativement étroite, de climat tropical.
Memphis
Lorsque, au nord de l'antique Memphis, il s'étale en sept branches dans l'ancien golfe marin, colmaté par le limon qu'il charrie, on a une vaste plaine, sillonnée de canaux qui se terminent vers la mer par d'impénétrables fourrés.
Climat
Parfois, il pleut, surtout dans la partie nord ; beaucoup d'arbres à feuilles caduques marquent nettement la distinction entre l'été et l'hiver.
Végétation
Une végétation méditerranéenne croît jusqu'à une centaine de kilomètres de la côte. La Basse Égypte s'oppose à la Haute-Égypte. La dualité du pays est réelle, même si ensuite elle devient en quelque sorte mythique. Mais l'ensemble est voué à l'unité. Depuis l'union du double-Pays par le roi Ménès, toute division a été pour l'Égypte une catastrophe.
Prospérité
La prospérité est fonction d'une organisation unifiée depuis la première cataracte jusqu'à la mer : creusement des canaux, retenue plus ou moins prolongée des eaux, réserves destinées à parer aux besoins en cas d'irrégularités de la crue.
Territoire
Mais la longueur même du territoire, en des temps où les communications étaient beaucoup plus lentes qu'aujourd'hui, favorisait son morcellement.
Pharaon
Aussitôt que la poigne du pharaon se relâchait et que les particularismes locaux aboutissaient à des royautés ou tout au moins à des principautés multiples, c'était la misère dans la vallée et l'invasion étrangère.
Nomades
Les nomades asiatiques qui poussaient leurs troupeaux dans les déserts, à l'ouest du Sinaï, avaient tendance à aller chercher l'eau et le fourrage sur les confins cultivés de l'Égypte, naturellement, ils pillaient quand on ne voulait pas leur accorder ce qu'ils demandaient.
Libyens
Ils s'infiltraient et parfois les Libyens s'installaient, à l'ouest, Ils avaient plus de facilités pour se déplacer le long de la côte, il y avait toujours un peu de pâture, quelques arbres et des points d'eau.
Périodes
On appelle communément « périodes intermédiaires » ces moments où se relâcha le pouvoir royal, mais nous éviterons ce mot qui ne signifie rien pour garder le terme de « royautés multiples », très clair par lui-même.
Histoire
Elles se situent après la VIe et après la XIIIe dynastie. L'histoire de l'Égypte pharaonique est celle de l'alternance de centralisation accompagnée d'extension territoriale et de développement social et d'émiettement du pouvoir, lié à l'invasion étrangère et à la décadence.
Prospéré
L'Égypte des pharaons a prospéré pendant près de 3 millénaires. Aucun autre État ni aucune autre civilisation ne peut en dire autant.
Grandeur
Elle doit en bonne partie sa longévité et sa grandeur à son environnement géographique : une vallée fertile isolée par le désert.
 L'Égypte est une étrange réalité / Photo Colette Colognac.
L'Égypte est une étrange réalité / Photo Colette Colognac.
Sahara
Vers 6500 av. J.-C., le Sahara précédemment fertile se transforme en désert. Ses habitants cherchent leur survie en se regroupant sur les bords du Nil.
Fleuve
Né au sud, dans les montagnes d'Éthiopie, le fleuve coule vers la Méditerranée, au nord, en traversant le désert sur plus de mille kilomètres.
Fonte
Tous les ans, en septembre, gonflé par la fonte des neiges d'Éthiopie, il sort de son lit et inonde sa vallée, en se retirant, au mois de décembre, il laisse dans la vallée un limon très fertile, il s'agit de la terre arrachée aux hauts plateaux d'Éthiopie.
Paysans
Les paysans de la vallée arrivent très vite à tirer le meilleur parti des crues du fleuve. Grâce au limon, ils obtiennent en un temps record d'abondantes récoltes de céréales.
Résultats
Ces résultats sont rendus possibles grâce à une mise en commun des efforts de tous et à des règles strictes pour le partage des terres et l'entretien des canaux d'irrigation et de drainage.
Roi
Le roi du pays (désigné sous le terme de pharaon) devient le garant de l'ordre social et s'avère indispensable à la gestion des crues périodiques. Il est assisté par de nombreux fonctionnaires et des scribes sélectionnés pour leur maîtrise de l'écriture.
Hypothèse
Certains archéologues émettent l'hypothèse que les besoins administratifs sont à l'origine de l'écriture égyptienne, à base de hiéroglyphes (idéogrammes), à peu près contemporaine de l'écriture cunéiforme de Mésopotamie (ou même antérieure).
Crue
Pendant la crue du fleuve, quand il est impossible de travailler dans la vallée, les paysans se mettent au service de l'administration royale et construisent des canaux d'irrigation, des digues, mais aussi des temples, des palais et des tombeaux.
Hérodote
Le voyageur grec Hérodote, découvrant le royaume des pharaons sur son déclin, a pu écrire avec une grande justesse : « L'Égypte est un don du Nil » .
Empire
Sous l'Ancien Empire, les Égyptiens tendent à penser que seuls les pharaons et leur entourage méritent d'être momifiés et d'accéder à la vie éternelle.
Tombeaux
D'où les énormes tombeaux en pierre que se font construire les premiers pharaons dans l'espoir que leur cadavre y soit conservé à l'abri des pillages et de la putréfaction. Au fil des siècles, ils accèdent à l'idée plus réconfortante que la résurrection est accessible à tout un chacun.
 L'Égypte est une étrange réalité / Photo Colette Colognac.
L'Égypte est une étrange réalité / Photo Colette Colognac.
Sphinx
Le Sphinx, les tombeaux des pharaons, les momies, les grandes pyramides. L’Égypte est une destination mythique et il suffit de se retrouver une seule fois devant un temple de 4 000 ans recouvert de hiéroglyphes pour comprendre pourquoi. En voyageant le long du Nil, on est assuré de découvrir de nombreuses merveilles. En voici quelques-unes !
 Le grand temple de Ramsès II d’Abou Simbel.
Le grand temple de Ramsès II d’Abou Simbel.
Temple
Près de la frontière soudanaise, au cœur de l’ancien royaume de Nubie, le grand temple de Ramsès II d’Abou Simbel compte parmi les plus impressionnants d’Égypte.
Façade
Sa façade de 30 mètres de haut est sculptée dans la falaise et flanquée de quatre immenses colosses de pierre représentant le fameux pharaon, qui a régné au 13e siècle avant notre ère.
 Assouan dans l’égyptien ancien avait pour nom Swenet qui signifie commerce assume son rôle de sanctuaire de l’histoire de la Méditerranée.
Assouan dans l’égyptien ancien avait pour nom Swenet qui signifie commerce assume son rôle de sanctuaire de l’histoire de la Méditerranée.
Assouan
Que ce soit pour son souk animé (rempli de cafés où l’on fume la shisha, de paniers de dattes et de petits sphinx en toc), pour ses temples de Philae (joliment isolés sur une île du Nil) ou pour son grand hôtel Old Cataract (construit par Thomas Cook en 1899 et ayant accueilli Agatha Christie !)
Ville
La ville d’Assouan est un incontournable. Aux portes de la Nubie, plusieurs croisières sur le Nil y débutent.
 Le Temple d’Horus à Edfou / Photo Colette Colognac.
Le Temple d’Horus à Edfou / Photo Colette Colognac.
Horus
Construit au 1er siècle avant notre ère, le temple d’Horus, à Edfou, est particulièrement bien préservé. Ses deux faucons de granit noir, son pylône (façade) de 36 mètres de haut et ses murs, complètement couverts de hiéroglyphes sont impressionnants, tout comme son spectacle sons et lumières en soirée.

Le temple de Kom Ombo / Photo Colette Colognac.
Temples
Les temples ne manquent pas en Haute Égypte, dans la partie sud du Nil. Celui de Kom Ombo a de particulier qu’il était dédié à Sobek, le dieu à la tête de crocodile.
Musée
Dans le petit musée adjacent, on découvre avec fascination une vingtaine de momies de crocodiles vieilles de 4 000 ans, trouvées quelques kilomètres plus loin dans le cimetière d’El Shabt, aux côtés de quelque 200 momies humaines.
 Le temple de Karnak a Louxor dans la nuit.
Le temple de Karnak a Louxor dans la nuit.
Lac
Au Sud de l’angle des deux grands axes de Karnak, se situe le grand lac sacré. L’eau provient de la nappe phréatique. (80 mètres x 130 mètres). C’est une forme visible du Noun, l’océan d’énergie primordiale. Ce lac avait vraiment plusieurs fonctions :
- il servait à la navigation des barques rituelles lors de mystères auxquels participaient un petit nombre d’initiés.
- il servait également de lieu où se purifiaient les officiants chargés de participer aux rituels quotidiens.

Le lac sacré (80 mètres x 130 mètres) / Photo Colette Colognac.
Louxor
Anciennement nommée Thèbes, Louxor est une ville égyptienne de 500 000 habitants, où les commerces modernes et les calèches taxis se mêlent aux ruines de l’Antiquité. On y découvre deux temples célèbres qui étaient autrefois reliés par une allée de sphinx de pierre de 3 km de long.
Construit
Il s’agit des temples de Louxor et de Karnak, Construit par plusieurs Pharaons entre 2200 et 360 av. J.-C., le temple de Karnak héberge le grand temple d'Amon, d'autres petits temples et sanctuaires ainsi que le grand lac sacré, Hatchepsout, Séthi Ier, Ramsès II et Ramsès III sont les Pharaons les plus importants qui ont participé à sa construction.
Salle
La salle des colonnes est sûrement la partie la plus impressionnante du temple. Avec plus de 5 000 mètres carrés, elle contient 134 colonnes.
Colonnes
Les 12 colonnes centrales sont plus larges et soutiennent le toit, aujourd'hui détruit, à 23 mètres de hauteur, a l'entrée du temple (avant de franchir le premier pylône), 40 sphynx à la tête de bélier vous accueilleront. Ils constituent le début de l'avenue des sphinx, qui s'étendait jusqu'au temple de Louxor et au Nil.
Grandiose
Le premier est à voir pour ses colosses de pierre qui deviennent dorés au coucher du soleil, le second, immense et quatre fois millénaire, est considéré comme le complexe religieux le plus grandiose de toute l’Egypte antique.
 La vallée des Rois.
La vallée des Rois.
Hiéroglyphes
Si vous rêvez de voir des murs tapissés de hiéroglyphes colorés, des sarcophages de pierre ayant jadis caché des momies sacrées et des antichambres souterraines autrefois remplies de trésors, c’est dans la vallée des Rois que vous devez aller.
Tombeaux
Situé près de Louxor, sur la rive ouest du Nil, c’est là que se trouvent enfouis les tombeaux des pharaons et de leur famille. Thoutmôsis, Aménophis, Ramsès, Séthi, Toutankhamon. Plus de 60 tombes royales y ont été mises à jour, datant de 1500 à 1100 avant notre ère. Incroyable !
 Les pyramides de Gizeh.
Les pyramides de Gizeh.
Gizeh
Situées dans les dunes du Caire, tout près des limites de la ville, les pyramides de Gizeh ne laissent personne indifférente.
Pyramides
Le site compte trois pyramides principales : Khéops, Khéphren et Mykérinos. La première est la seule des sept merveilles du monde antique qui soit encore debout, et on peut pénétrer à l’intérieur par un long passage sombre et étroit.
La découverte de la mystérieuse grotte de Lascaux
 Une récente visite de contrôle dans le puits par la conservatrice Muriel Mauriac. © Crédit photo : Drac Nouvelle Aquitaine.
Une récente visite de contrôle dans le puits par la conservatrice Muriel Mauriac. © Crédit photo : Drac Nouvelle Aquitaine.
En 1940, en Dordogne, des enfants découvraient une mystérieuse grotte. Il y a plus de 80 ans, la découverte d’un physicien américain allait bouleverser la recherche historique.
Histoire
C’est le carbone 14. Grâce à cet élément radioactif, un mystère allait pouvoir être éclairci. Découvrez l'histoire de la découverte de la grotte de Lascaux.
Armistice
Depuis l’armistice du 22 juin 1940, le département de la Dordogne fait partie de la zone libre, au sud de la ligne de démarcation.
Montignac-sur-Vézère
Le 12 septembre 1940 , parce que dans les bois de Montignac-sur-Vézère, leur chien, appelé Robot, s’excite devant l’entrée d’un souterrain, quatre garçons se persuadent que c’est un passage secret.
Périgourdins
Pour ces jeunes Périgourdins, il devait sûrement conduire au trésor du château de Montignac. On en parlait dans la région depuis longtemps. On ne savait pas en quoi il consistait, mais on assurait même qu’il vaudrait une trentaine de millions de l’époque !
Adolescents
De quoi faire rêver des adolescents ! L’un des jeunes gens, Marcel Ravidat, d’abord seul, découvre une ouverture dans la colline au bord du plateau dominant la Vézère. Quatre jours plus tard, il revient avec ses amis Jacques Marsal, Georges Agniel, et Simon Coencas. Les garçons, au moyen d’une corde, s’enfoncent dans l’inconnu.
Lueur
Soudain, à la lueur vacillante de torches, ils font une découverte stupéfiante. Ce qui semblait être un trou de renard est, en réalité, l’amorce d’une cavité.
Lumière
Comme l’éclairage est insuffisant, ils ressortent et dans une ferme voisine, ils dénichent une pompe. Munie d’une mèche imprégnée de pétrole, elle leur fournit une lumière plus forte.
Découverte
Ce qu’ils voient les stupéfie : sur les parois d’une galerie, ils découvrent de grands dessins colorés. De l’ocre, du jaune, du violet, un incroyable bestiaire : sur une vingtaine de mètres, sont représentés de grands taureaux, des cerfs, des aurochs, des chevaux plus petits que les autres animaux.
Taureau
La plus grande représentation mesure environ 5,50 m de long. Un taureau géant ! Dans un silence de cathédrale, ce spectacle est fantastique !
Animaux
Comment est-il possible de trouver une telle accumulation graphique sous la terre ? Qui a peint ces animaux ? Et surtout Emus, les inventeurs de ce trésor inattendu ne vont pas plus loin.
Émerveillés
Ils sont émerveillés, mais tout de même pas très rassurés ! Ils ressortent et font part de leur découverte à M. Laval, le seul archéologue du pays de Montignac.
Maurice Thaon
Mais celui-ci, souffrant, s’il les croit, ne peut se déplacer. Il charge un de ses amis, Maurice Thaon, de vérifier cette nouvelle.
Croquis
Ce dernier se rend dans la grotte, fait de nombreux croquis de ce qu’il voit et confirme les dires des adolescents.
Abbé
Il porte immédiatement ses dessins à l’abbé Henri Breuil. cet ecclésiastique est un célèbre préhistorien, membre de l’Académie des Inscriptions et des Belles lettres, professeur au Collège de France.
Paléolithique
Sa spécialité est l’art paléolithique. Il a déjà participé à la découverte et à l’authentification de plusieurs grottes. Dès le lendemain, l’abbé Breuil et deux collègues se rendent dans ce qu’on appelle désormais la grotte de Lascaux.
Experts
Celle-ci est, pour la première fois, visitée d’une façon scientifique, par des experts. L’abbé Breuil n’en doute pas Lascaux est la plus importante grotte ornée découverte depuis une cinquantaine d’années.
Peintures
L’ampleur et la qualité des peintures permettent de les comparer à celles de la grotte d’Altamira, découverte en Espagne en 1879, qu’il a étudiées.
Crypte
L’abbé Breuil est émerveillé. Il est frappé par l’analogie de ce lieu avec la crypte d’une basilique. Il déclare que Lascaux "est la Chapelle Sixtine de la Préhistoire". La formule, remarquable, devient vite célèbre. Le préhistorien dresse une nomenclature rapide des peintures, il y en a cent vingt. Curieusement, il n’y a ni Rennes ni mammouths.
Ours
Mais des ours, des lions et des bisons sont identifiés. Dans ce qu’on appelle aujourd’hui, le puits, une scène est particulièrement intéressants : c’est celle d’un homme qui gît renversé près d’un bison éventré, qui perd ses entrailles. À l’évidence, il y a eu un combat entre l’animal et l’homme.
Blessé
Celui-ci, blessé, est représenté par un simple trait noir, à la manière d’un dessin d’enfant, mais son anatomie est correcte.
Personnage
Ce personnage est observé par un oiseau tandis qu’un rhinocéros semble s’éloigner. On peut véritablement supposer que c’est l’évocation d’une chasse.
Images
L’abbé Breuil et ses compagnons remarquent que certaines de ces images ont été repeintes modifiées reprises complétées par des contours différents comme si l’artiste avait eu des remords.
Traits
Il y a des superpositions de traits et de couleurs. Ce sont des hésitations que connaissent, à toutes les époques et dans tous les genres, bien des illustrateurs.
Analyses
Les analyses radiographiques l’ont déjà prouvé. Parfois, on peut aussi penser que le dessin primitif a été utilisé, plus tard, par d’autres artistes que l’auteur initial. Mais comment savoir le temps qui s’est écoulé entre les premiers traits et les corrections ultérieures ?
Exploration
En continuant leur exploration de Lascaux, les préhistoriens découvrent des lampes, des sagaies, des éléments de parures, des restes d’échafaudages, de colorants et de pierres ayant servi à graver les scènes dans la roche.
Œuvres
Si ces œuvres sont déjà fascinantes et suscitent toutes, sortes d’interrogations, la configuration de la grotte n’est pas moins intéressante.
Salle
La grande salle, orientée au sud-sud-est, mesure 32 mètres de long sur 10 mètres de large. Elle est prolongée par une sorte de couloir de 18 mètres.
Galerie
Puis, une nouvelle galerie de 16 mètres, dont la voûte est très basse, aboutit à une petite salle triangulaire. Là, s’ouvre ce qu’on appellera, en exagérant, le gouffre, en réalité, c’est une faille de 5 mètres.
Artistique
Il y a encore d’autres galeries, des puits, des passages difficiles. Une certitude s’impose : que l’on soit préhistorien ou profane, on est doublement ému, par l’étonnante conservation de ces peintures, mais aussi par le sens artistique des hommes vivant à l’époque de la pierre taillée, il y a des milliers d’années.
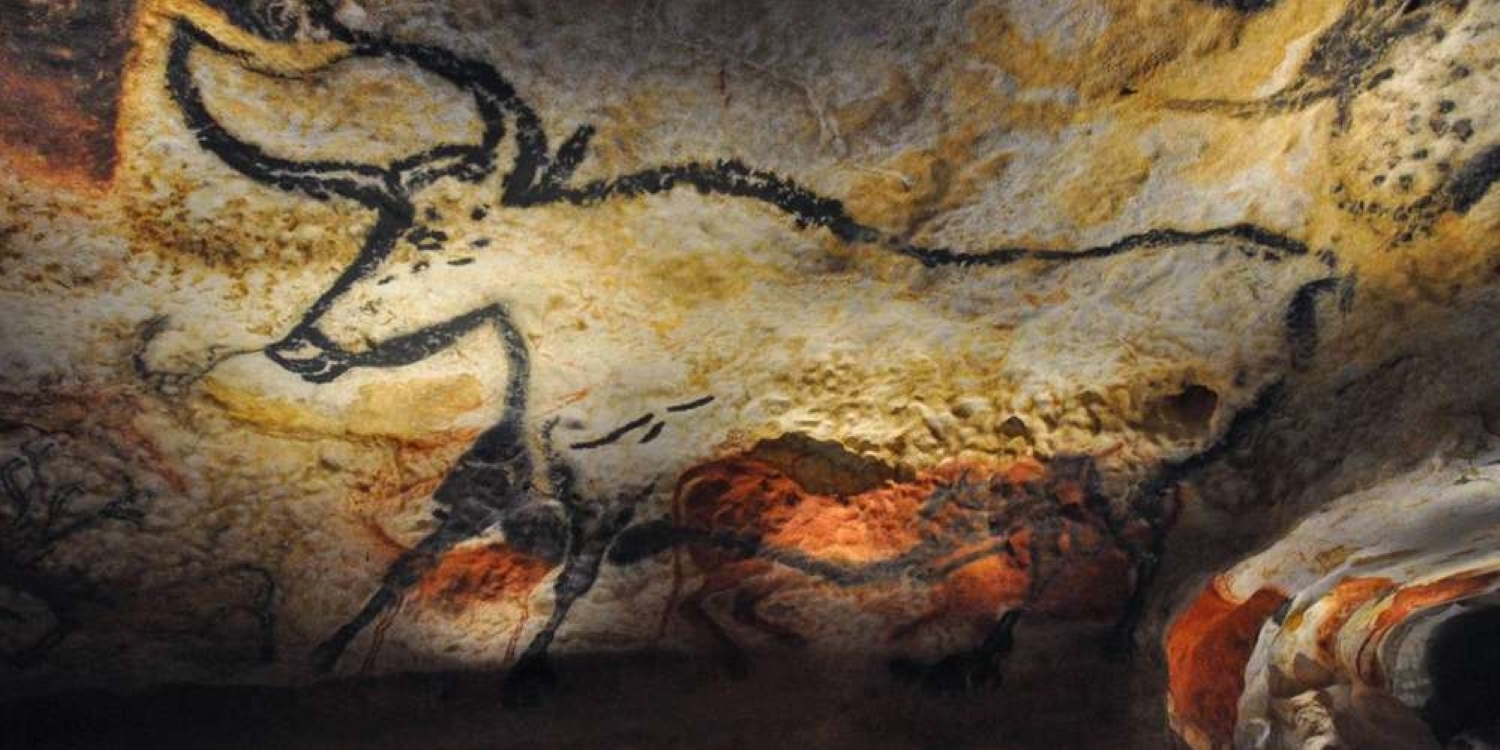 Lascaux se prête mal à la technique de datation au carbone 14, car on ne trouve pas de matière organique dans ses peintures © Crédit photo : archives Philippe Greiller.
Lascaux se prête mal à la technique de datation au carbone 14, car on ne trouve pas de matière organique dans ses peintures © Crédit photo : archives Philippe Greiller.
Monument
La paix revenue, la grotte de Lascaux est classée monument historique en 1948 et ouverte au public. Un débat entre spécialistes autorise l’abbé Breuil à rattacher les trésors de Lascaux à l’époque du périgordien supérieur, approximativement entre -24.000 ans et -19.000 ans.
Carbone 14
Mais un peu plus tard, avec le Carbone 14, isotope radioactif présent en faible quantité dans la nature, cette datation sera corrigée par d’autres recherches et une nouvelle méthode de datation qu’avait mise au point, en 1946, l’Américain Frank Libby. Il recevra le Prix Nobel de Chimie en 1960.
Datation
La datation de Lascaux est alors corrigée : l’ensemble est désormais situé au magdalénien ancien, soit environ entre -15.000 et -13.500 ans. Avec le Carbone 14, les merveilles de Lascaux rajeunissent de près de 10 000 ans ! Un lifting impressionnant !
Période
On estime que c’est une période d’apogée. Elle marie l’acuité de l’observation animale et l’élégance des moyens artistiques, en effet, la notion de perspective est présente dans les membres des animaux.
Relief
De même, le relief de la grotte est bien exploité. Loin d’être un obstacle, il est un avantage. Autrement dit, les artistes qui avaient 15.000 ans étaient déjà des professionnels : ils avaient transformé une grotte en galerie d’expositions !
Succès
Mais Lascaux est victime de son succès : on vient de très loin pour la visiter. Peu à peu, on constate des dégradations à cause d’une trop grande fréquentation touristique.
Fragile
La grotte est fragile, peu profonde et soumise, entre autres, aux variations du climat, de la température et à la respiration des visiteurs.
Champignons
Signe inquiétant : des champignons apparaissent sur les œuvres picturales. Les préhistoriens s’alarment : il faut sauver Lascaux, il n’est pas pensable qu’une telle merveille, qui a résisté à 15.000 ans, soit dégradée en deux décennies.
André Malraux
En 1963, André Malraux, ministre des Affaires Culturelles, fait fermer la grotte au public. Seuls des spécialistes pourront, au compte-gouttes, y avoir accès. Lascaux est, pour ainsi dire, en soins intensifs.
Fermeture
Cette fermeture est évidemment dommageable pour les passionnés de préhistoire et le tourisme. Il est indispensable de ne pas priver le public d’une telle plongée dans l’admiration de 1.500 gravure rupestres et de 680 peintures. Alors, commence un travail très délicat.
Réplique
Il faudra vingt ans pour réaliser une réplique, partielle, de l’original. En 1983, Lascaux 2 est ouvert. Il y a les pour et les contres.
Reproduction
Si 250.000 visiteurs annuels sont éblouis, ils ne peuvent voir qu’une reproduction, grandeur nature, de la salle des taureaux et du diverticule axial.
Lascaux 3
Afin d’atteindre un public rebuté par la fermeture de la véritable grotte, à partir de 2012, un modèle en kit, Lascaux 3, allait se promener à travers le monde !
Mobile
La location de cette grotte mobile est alors chiffrée entre 50.000 et 70.000 par mois. L’idée surprend, attire quelques curieux, mais elle n’est finalement pas jugée pertinente.
Réplique
Paléontologues, préhistoriens et autres gens de sciences plaident pour qu’une réplique complète soit présente sur son lieu historique.
Témoignage
Un endroit où l’humain d’il y a environ 150 siècles est devenu un artiste fascinant, nous léguant un témoignage aussi fabuleux que mystérieux et énigmatique.
 Lascaux 4 ouvre ses portes au public le 15 décembre (Mehdi Fedouach / AFP).
Lascaux 4 ouvre ses portes au public le 15 décembre (Mehdi Fedouach / AFP).
Lascaux 4
Un complexe, totalement nouveau, à 900 mètres plus bas de la grotte d’origine a été ouvert le 15 décembre 2016. Coût : 57 millions d’euros. Lascaux 4 est une réussite totale.
Reconstituer
L’ambition ne se limitait pas à reconstituer l’ensemble de la caverne, mais d’y ajouter l'abside, la nef et le puits.
Cro-Magnon
Il fallait montrer cet univers qui avait séduit notre ancêtre Cro-Magnon. Les ingénieurs ont conçu une modélisation en 3D, totalisant un relevé de 250 millions de points.
Reproduire
Elle permet de reproduire le volume avec une précision inégalée, au millimètre près. La paroi ainsi créée est un immense puzzle de 54 blocs où figurent les répliques des chefs-d’œuvre de l’art préhistorique.
Bâtiment
Le bâtiment, une longue ligne brisée de verre et de béton, d’une élégante sobriété, se fond dans le paysage au pied de la colline de Lascaux.
Sanctuaire
C’est un véritable sanctuaire des alentours, afin de respecter les exigences de l'État et de l’Unesco, qui a inscrit la grotte "historique" au patrimoine mondial de l’humanité.
Illusion
Le visiteur grimpe sur un belvédère qui descend en pente douce, au milieu de la forêt, vers la porte d’entrée. L’illusion est parfaite, l’émotion intacte.
Fraiseuse
Une fraiseuse numérique a restitué le moindre centimètre de relief avant d’être moulé en l’enduisant d’élastomères et autres, polymères.
Francis Ringenbach
Lascaux devient, ici, un monument d’art plastique ! La paroi blanche a servi de support à un important groupe de peintres et de graveurs. Francis Ringenbach, directeur des fac-similés du Périgord, la PME chargée de cette étape cruciale du projet, explique leur travail :
Redessiner
"Pendant des mois, ils ont esquissé puis coloré avec de l’encre rouge, jaune et brun (pigmenté par de l’oxyde de fer ou du manganèse) de la terre et de l’argile pour redessiner les fresques originelles".
Travail
Pour ce travail exceptionnel et inédit, 34 peintres copistes se sont succédé afin de réaliser, à l’identique, 500 mètres carrés de parois révélant des merveilles de l’art pariétal.
Labeur
Un labeur minutieux, à l’aide d’un rétroprojecteur calquant sur la paroi l’image capturée, dans la grotte, en reproduisant sa position initiale, cela n’empêchait pas d’utiliser les mêmes outils qu’au Paléolithique.
Assemblés
Enfin, un à un, les panneaux ont été transportés jusqu’au site d’exposition où ils ont été assemblés sur une structure métallique, dans un enchevêtrement de câbles et de tuyaux.
Réplique
Dans une salle attenante à la réplique, quelques-unes des plus belles peintures sont reproduites à hauteur d’homme, afin de rendre accessibles et visibles les moindres détails.
Yves Coppens
Pour Yves Coppens, paléontologue, professeur au Collège de France et président du Conseil Scientifique de Lascaux depuis 2010, organisme mis en place par le ministre de la Culture Frédéric Mitterrand de l’époque.
Originale
La grotte originale de Lascaux conserve encore ses secrets : "les animaux semblent mélangés, mais ils ne le sont sûrement pas".
Mémoire
Il y a des signes d’entrée (la licorne qui vous accueille) et de fin (ces félins qui intiment l’ordre de ne pas aller plus loin). Ces lieux sont remplis de mémoire. L’essentiel est de savoir lire cette mémoire.
Fragile
La grotte est toujours très fragile, car elle est vivante, mais nous avons réussi une stabilisation. C’est une diva pour laquelle il faut rester vigilant, mais pendant toutes ces années, elle n’a pas fait de crise de colère ou de jalousie.
Taches
Pour autant, les attaques de champignons ne sont pas derrière elles. Les petites taches noires n’ont pas complètement disparu. Elles apparaissent encore un peu, mais parfois disparaissent et il faut savoir les traiter. Je veux seulement que d’autres yeux voient ce que nous voyons.
Heureux
"Je suis heureux de laisser une grotte présentable par rapport aux risques qui se présentaient".
Artistes
Les artistes chasseurs ne vivaient pas dans la grotte d’origine puisqu'aucune trace d’occupation n’a été exhumée.
Mystères
Depuis quatre-vingts ans, Lascaux conserve encore son mystère, comme "le cheval renversé" qui montre un animal à l’envers, enroulé autour d’un pilier ou "les bisons adossés" où les deux bêtes se tournent le dos.
Extraordinaire
Dans cette extraordinaire réplique, Lascaux 4, avec ses 900 animaux sur seulement 250 mètres de long, dont certains mesurent plus de 5, 5 0 mètres, reconstitue un fabuleux bestiaire minéral.
De mystérieuses traces ADN découvertes dans des grottes de glace en Antarctique
 Creusées par la chaleur libérée par les volcans, ces grottes sont éclairées par la lumière du jour filtrée au travers de la glace en surplomb et la température y atteint 25 degrés.
Creusées par la chaleur libérée par les volcans, ces grottes sont éclairées par la lumière du jour filtrée au travers de la glace en surplomb et la température y atteint 25 degrés.
Selon des chercheurs australiens, de nouvelles espèces d'animaux et de plantes pourraient vivre sous la glace.
Monde
Un monde mystérieux d'animaux et de plantes, dont certaines espèces potentiellement inconnue s, pourrait exister dans des grottes creusées par l'activité volcanique sous les glaciers de l'Antarctique, affirment des chercheurs australiens.
Volcans
Creusées par la chaleur libérée par les volcans, ces grottes sont éclairées par la lumière du jour filtrée au travers de la glace en surplomb et la température y atteint 25 degrés, indiquent ces scientifiques qui avancent l'hypothèse de l'existence d'un écosystème propre, loin de la surface.
Journal
Publiée par le journal Polar Biology, l'étude conduite par l'Université nationale australienne dans le secteur du Mont Erebus, le volcan actif le plus austral du monde, a permis de montrer l'existence d'un important réseau de grottes.
Ceridwen Fraser
La chercheuse Ceridwen Fraser a déclaré que l'analyse d'échantillons de sol prélevé dans les grottes avait révélé des traces intrigantes d'ADN provenant d'algues, de mousses et de petits animaux. Si la plupart sont similaires à celles d'organismes vivants connus, certaines séquences ADN n'ont pas pu être identifiées.
Espèces
"Il se pourrait même qu'il y ait de nouvelles espèces d'animaux et de plantes", a-t-elle ajouté. "Les résultats de cette étude nous donnent des perspectives alléchantes quant à ce qui pourrait vivre sous la glace de l'Antarctique".
Étape
"La prochaine étape sera d'aller chercher pour voir si on peut trouver des populations vivant sous la glace de l'Antarctique."
Vie
Elle a expliqué qu'en dépit des températures glaciales de l'Antarctique, la chaleur dégagée par la vapeur émanant du volcan pouvait rendre les grottes propices à la vie, du fait de la lumière filtrant au travers de la glace là où celle-ci est peu épaisse.
La Bête du Gévaudan
 La Bête du Gévaudan reconstituée par un passionné. La reconstitution respecte les 31 mesures relevées sur le rapport d’autopsie du 20 juin 1767 © DR.
La Bête du Gévaudan reconstituée par un passionné. La reconstitution respecte les 31 mesures relevées sur le rapport d’autopsie du 20 juin 1767 © DR.
Des femmes et des enfants tués par une bête mystérieuse et sanguinaires. Des paysans terrifiés, la presse déchaînée et le roi qui s'en mêle.
Histoire
Telle est l'histoire de la bête du Gévaudan, un mystère qui n'a jamais cessé de fasciner, du 30 juin 1764 au 19 juin 1767, entre 82 et 124 personnes furent victimes de la Bête du Gévaudan !
Attaques
Ces attaques eurent lieu dans un vaste territoire qui recouvre aujourd’hui les départements de la Lozère, du Cantal et de la Haute-Loire.
Événements
Dès l’origine, ces événements vont prendre une ampleur considérable du fait d’une médiatisation internationale sans équivalents ! Des gravures de la Bête sont publiées partout, de Paris à San Francisco !
Éditoriaux
La fin de la guerre de Sept Ans laisse un vide béant dans les éditoriaux des gazettes, jusqu’à ce que la Gazette d’Avignon s’empare de l’affaire. Son rédacteur sut habilement broder autour des nouvelles assez lacunaires qui provenaient du terrain.
Protéger
Cette pression médiatique poussa le roi, Louis XV, à l’action. Discrédité par la perte du conflit, il doit affirmer sa capacité à protéger le Royaume.
Gévaudan
Le Gévaudan est une ancienne province française située en Auvergne. Terre d'élevage, le Gévaudan se composait alors essentiellement de prairies et des Landes. Les attaques de loups y étaient fréquentes, parfois mortelles, mais n'émouvaient pas l'opinion plus que cela.
Territoire
Loin d’être aussi boisé qu’aujourd’hui, ce vaste territoire se compose des Landes et de prairies de pâturage que ponctuent des bosquets et quelques maigres forêts (Mercoire, de La Tenazeyre, bois de Pommier…).
Bête
La Bête n’était pas un simple loup comme trop d’auteurs l’ont affirmé par facilité. Si les paysans ont spontanément parlé de Bestia, Bestiaou, Bestieu, Bestio, c’est bien que celle-ci se différenciait du loup ; des loups.
Victimes
Ils en voyaient au quotidien et ne pouvaient donc faire la confusion. D’ailleurs, la plupart des victimes n’étaient pas consommées ; la Bête tuait plus par jeu que par nécessité.
Animal
Si la Bête n’était pas un loup, ni un homme agissant seul, la Bête était-elle donc un animal conçu par l’homme, ou introduit dans ce pays par celui-ci ?
Question
La réponse à cette question mérite réflexion. Nous pensons que la Bête était sans doute une association diabolique mettant en jeu l’homme et un animal dressé à cet effet.
Évidence
C’est même une évidence, une Bête seule n’aurait pu agir aussi longtemps sans être tuée, capturée, ou empoisonnée, elle dépendait étroitement de l’homme pour s’abriter, se nourrir et être soignée.Contrairement aux agissements des loups, qui eux vivent et chassent en groupe.
Série
À noter aussi et c'est édifiant qu’aucune autre série de ce type, et imputable au loup, n’est signalée ailleurs dans le monde.
Femme
Tout change pourtant en juin 1964 lorsqu'une femme vivant à Langogne est grièvement blessée alors qu'elle garde son troupeau.
Témoins
Les témoins assurent que l'animal qui s'en est pris la malheureuse n'est pas un loup, mais un animal beaucoup plus imposant.
Grosse
On évoque une bête aussi grosse qu'un âne, avec une mâchoire puissante et des dents acérées, un pelage gris et touffu teinté de rouge. Quelques jours plus tard, une adolescente est attaquée à son tour et succombe à ses blessures.
Attaques
Pendant trois ans, les attaques se multiplient et la créature tue entre 88 et 124 personnes. Les témoins assurent que l'animal qui s'en est pris la malheureuse n'est pas un loup, mais un animal beaucoup plus imposant.
Descriptions
Les descriptions de la bête se précisent, mais se teintent peu à peu d'attributs fantastiques. On évoque un loup gigantesque, mais la rumeur court que la créature pourrait en réalité être un homme croisé avec une bête, ou un homme cannibale vêtu d'une peau de bête.
Peur
La peur gagne toute la région et les différentes battues organisées pour capturer l'animal ne donnent rien.
 Figure du Monstre qui désole le Gévaudan. Gravure sur cuivre de 1764-1765.
Figure du Monstre qui désole le Gévaudan. Gravure sur cuivre de 1764-1765.
Affaire
L'existence d'une bête tueuse dans le Gévaudan aurait pu demeurer cantonnée à la rubrique des faits divers. Pourtant, l'affaire va prendre une ampleur nationale. La presse régionale se fait bien entendue l'écho des attaques et la Gazette d'Avignon va multiplier les articles.
Rédacteur
Peu importe, le rédacteur va broder autour de témoignages parfois peu fiables, extrapoler, échafauder des théories, les lecteurs se passionnent alors pour le mystère.
Célèbre
La bête du Gévaudan devient célèbre dans tout le pays, et même au-delà, les journaux allemands et britanniques lui consacrent également des dizaines d'articles. La pression médiatique est telle que Louis XV dépêche des équipes sur place pour tenter d'arrêter le massacre.
Influence
L’influence de la famille Choiseul ne doit pas être sous-estimée dans cette affaire. En effet, si le duc Etienne-François de Choiseul est le plus proche ministre du Roi, son cousin n’est autre que le comte-évêque de Gévaudan. Dans un texte resté célèbre sous le nom du « Mandement de l’évêque de Mende ».
Fléau
Ce dernier qualifie la bête de fléau divin et donne donc une dimension mystique à cette affaire. En tant que représentant du pouvoir temporel.
Évêque
l’évêque assure, par le biais de ses services, un suivi dans la traque, et l’envoi du porte-arquebusier du roi n’est sans doute pas étrangère à ses relations avec son cousin.
Battues
Au cours de cette période, de nombreuses battues furent organisées et parmi le grand nombre de loups éliminés, deux grands canidés furent tués.
François Antoine
Le premier par le porte-arquebusier François Antoine le 20 septembre 1765 au Bois de Pommier puis un second par Jean Chastel 19 juin 1767 à la Sogne d’Auvers, la mort de cet animal met un point final aux attaques dans la région.
Canidé
Le 20 septembre 1765 au Bois de Pommier, sur le domaine de l'abbaye royale des Chazes, le porte-arquebusier du roi François Antoine tue un grand canidé. La dépouille est disséquée et examinée, plusieurs survivants des attaques disent reconnaître l'animal.
Versailles
Le corps de la bête est acheminé jusqu'à Versailles pour être empaillé et exposé dans les jardins du château. Pour le roi, l'affaire s'arrête là.
Accalmie
Mais dans le Gévaudan, après une accalmie, les attaques reprennent et la liste des victimes s'allonge... Il faut attendre le 19 juin 1767 pour que Jean Chastel, un enfant du pays, abatte un canidé de grande taille à la Sogne d’Auvers. Les attaques cessent cette fois.

Battue
En juin 1767, le marquis d'Apcher mène une battue, sur le Mont Mouchet dans le bois de la Ténazeire, accompagné de quelques volontaires voisins, dont Jean Chastel, réputé excellent chasseur. Ce dernier, posté sur la Sogne-d’Auvert, près de Saugues, voit la Bête venir à lui.
Immobile
Comme celle-ci reste immobile, Chastel épaule, vise et tire. La Bête est morte. Sa dépouille, chargée sur un cheval, est aussitôt portée au château de Besques, examinée, puis promenée dans tout le pays, avant d'être emmenée à Versailles.
Putréfaction
La Bête y arrive dans un état de putréfaction avancée et est rapidement enterrée. Maigrement récompensé par le roi, Jean Chastel fut, en revanche, porté en héros, par tous les habitants de la province du Gévaudan.
Paix
La région retrouve la paix et l'histoire légendaire de l'animal traverse les siècles, inspirant écrivains et cinéastes. Mais si la bête du Gévaudan a bel et bien existé, sa véritable nature demeure encore, 300 ans plus tard, un mystère.

Le Parthénon d'Athènes
 Érigé entre 447 et 438 av. J.-C. dans l'Acropole, le Parthénon est l'un des monuments les plus importants de la civilisation de la Grèce antique,
Érigé entre 447 et 438 av. J.-C. dans l'Acropole, le Parthénon est l'un des monuments les plus importants de la civilisation de la Grèce antique,
Le Parthénon est l'un des symboles archéologiques les plus connus de toutes les civilisations. Construit en quinze ans, ce temple de la Grèce antique remplace un autre que les Perses ont détruit en 480 av. J.-C.
Temple
À l'époque, on s'étonne qu'un temple si grand (30,9 m x 69,5 m) soit élevé en si peu de temps, mais ce qui est encore plus étonnant, c'est la qualité de la construction et de la finition, qui est superbe.
Périclès
Le temple est édifié à l'instigation de l'homme d'État le plus important de l'époque, Périclès.
Construction
Selon Plutarque, le grand biographe grec qui écrit des siècles après l'achèvement de l'édifice, la construction du Parthénon et des autres temples qui l'entourent a été motivée notamment par le chômage, qui s'aggravait.
Travaux
En entreprenant de grands travaux publics sur l'Acropole (la colline qui domine Athènes, où le Parthénon et d'autres temples dédiés aux dieux sont situés).
Travail
Périclès espère offrir du travail aux Athéniens ordinaire, menuisiers, maçons, ivoiriers, peintres, émailleurs, modeleurs, forgerons, cordiers, tisserands, graveurs, marchands, orfèvres (travail du cuivre), potiers, cordonniers, tanneurs, ouvriers, etc.
Chef-d'œuvre
Fait plus important, Périclès voit dans le Parthénon un chef-d'œuvre architectural qui communiquera au monde la supériorité des valeurs d'Athènes, de son système de gouvernement et du mode de vie de ses habitants.
Meilleurs
Pour cette raison, il n'accepte que les meilleurs matériaux de construction, la meilleure pierre, du bronze, de l'or, de l'ivoire, de l'ébène, du bois de cyprès, et les meilleurs artistes et artisans.
Édifice
Le Parthénon doit être un édifice pour tous les temps. Dans une oraison funèbre prononcée en 430 av. J.-C., Périclès déclare jusqu'à quel point il est fier de la ville d'Athènes, et il pense sans aucun doute au Parthénon lorsqu'il proclame.
Hommes
« Les marques et les monuments que nous avons laissés sont effectivement très grands. Les hommes de l'avenir s'émerveilleront de nous, comme le font tous les hommes aujourd'hui. »
Projet
Le nouveau projet de construction n'est pas bien accueilli par tout le monde. Certaines personnes sont outrées en voyant les vastes sommes qu'on dépense « pour dorer et embellir notre ville comme si elle était une femme vaniteuse qui se pare de pierres dispendieuses et de temples qui ont coûté mille talents ».
Fonds
Beaucoup protestent également le fait que les fonds engagés dans la construction du Parthénon proviennent d'alliés d'Athènes, qui les fournissent, à contrecœur, pour financer des guerres contre les Perses.
Athéniens
Périclès affirme que, tant que les Athéniens respecteront leurs engagements en défendant ces alliés contre les agresseurs perses, les alliés n'auront aucune raison de se plaindre.
Périclès
La majorité des gens appuient Périclès. En fait, la personne qui le critique le plus vivement est frappée d'ostracisme (bannie pendant dix ans) à la suite d'un jugement du peuple, rendant la construction possible.
Projet
Périclès dirige lui-même le programme de construction du Parthénon. Il demande à trois hommes qui sont au premier rang dans leur domaine de collaborer au design et à l'exécution du projet.
Ictinos
Nous ne savons pas tout ce qu'ils ont fait, mais, autant qu'on puisse en juger, Ictinos a été le principal architecte, et Callicratès , le maître d'œuvre et le coordinateur technique, tandis que Phidias a supervisé la création et l'intégration de tous les éléments artistiques.
Sculpture
Ce dernier crée lui-même l'énorme sculpture en or et en ivoire de la déesse de la ville et certains groupes de sculptures, tout en supervisant une petite armée d'artistes et d'artisans.
Phidias
Considéré à l'époque comme le plus grand sculpteur de son temps, Phidias est aujourd'hui reconnu comme le plus grand sculpteur grec de tous les temps. Les trois hommes ont collaboré avec succès tout le long du projet.
Construction
Il va sans dire que la construction du Parthénon exige de vastes sommes d'argent. (Selon des comptes publics gravés sur pierre, la construction a coûté 469 talents d'argent.
Équivalent
On n'a jamais calculé l'équivalent moderne de ce montant de façon satisfaisante.) Le principal matériau de construction est le marbre pentélique, qui provient du mont Pentélique, situé à environ 16 km d'Athènes.
Blocs
(L'ancien Parthénon, que les Perses détruisent durant la construction, est le premier temple en ce genre de marbre.) Les immenses blocs de pierre sont transportés jusqu'au chantier dans des chars à bœufs.
Qualité
Le Parthénon n'est pas du tout la structure la plus grande, mais ce qui le distingue de la plupart des autres temples, c'est la qualité et l'étendue des éléments sculptés.
Sculptures
Beaucoup de sculptures sont en marbre blanc provenant de l'île de Paros, un marbre plus cher que la plupart des sculpteurs préfèrent. En tant que collection qui montre l'art grec à son apogée, les marbres (sculptures) du Parthénon sont sans pareil.
Raffinements
Plusieurs raffinements esthétiques sont intégrés à l'édifice, qui est lui-même une œuvre d'art, de façon à le rendre le plus parfait possible visuellement.
Architectes
Sachant que les longues lignes horizontales semblent s'arquer, bien qu'elles soient parfaitement droites, les architectes courbent délibérément des éléments horizontaux et « grossissent » les colonnes au centre pour compenser les irrégularités de l'œil humain.
Impression
Cet épaississement au centre donne l'impression que les colonnes ploient un peu sous le poids du toit, rendant le temple moins statique, plus dynamique.
Géométrie
Bien que les lignes et les distances du Parthénon semblent droites et égales, la géométrie a été modifiée pour créer cette illusion, on dit que dans cet édifice « rien n'est ce qu'il semble être ».
Dorique
Le Parthénon est un temple dorique auquel on a ingénieusement intégré des éléments ioniques pour produire un édifice que bien des personnes, y compris certains des meilleurs architectes du monde, considèrent comme parfait.
Style
Le style dorique comporte des colonnes plus larges et a un aspect plus imposant (appelé parfois masculin) que le style ionique (féminin). Périclès a peut-être fait ce choix pour des raisons politiques, unissant symboliquement les Grecs d'origine dorienne et ionienne dans un édifice transcendant.
Périptère
Le Parthénon est un temple périptère, c'est-à-dire que la structure est entourée de colonnes. Il comporte en tout 46 colonnes : 8 sur chaque façade et 17 sur chaque côté.
Colonnes
À l'intérieur de ces colonnes, il y a une plate-forme surélevée en pierre qui soutient les murs d'une pièce rectangulaire appelée la cella ou le naos. Dans un temple traditionnel, il s'agit d'une seule pièce, mais la cella du Parthénon a été divisée en deux-pièces.
Statue
La plus grande abritait une énorme statue d'Athéna, debout sur un socle. Devant la statue, il y avait un miroir d'eau.
Trésor
Dans l'autre pièce, qui comporte quatre colonnes intérieures, se trouvait le trésor de l'État, y compris de la monnaie offerte à la divinité. Les colonnes intérieures aidaient à soutenir le toit, qui était en marbre, comme le reste de l'édifice.
Hécatompédon
La partie de la cella où se trouvait la magnifique statue d'Athéna s'appelle l'Hécatompédon (heka = 100) et est longue de cent-pieds athéniens (attiques), comme son nom grec l'indique.
Miroir
Le miroir d'eau permettait d'humidifier l'air et les éléments en ivoire de l'immense statue chryséléphantine (en or et en ivoire), qui pouvaient se dessécher et se fendre.
Statue
La statue a coûté plus que l'édifice qui l'abritait, et le sculpteur Phidias l'a conçue de façon à ce qu'on puisse en enlever les plaques d'or, les peser et les vendre, si nécessaire.
Décision
(Cette décision s'est avérée judicieuse parce que, plus tard, on a accusé Phidias d'avoir volé des plaques d'or, et il a pu prouver son innocence sans problème.)
 Les techniques de modélisation informatique les plus avancées permettent de présenter le Parthénon dans toute sa splendeur d'origine Courtesy MacGillivray Freeman Films.
Les techniques de modélisation informatique les plus avancées permettent de présenter le Parthénon dans toute sa splendeur d'origine Courtesy MacGillivray Freeman Films.
Frise
La célèbre frise du Parthénon était une bande continue de sculpture en haut-relief d'une longueur de 160 m. Elle entourait la cella au niveau du plafond. Il aurait été très difficile de voir et d'apprécier cette frise depuis le niveau du sol, l'endroit habituel d'où on pouvait la voir.
Haute
La frise était haute d'à peine un mètre, et le relief avait une profondeur d'environ 6,5 cm. (Phidias fait tailler la partie supérieure de cette profondeur et la partie inférieure un peu moins profonde pour qu'on puisse distinguer les scènes un peu mieux au niveau du sol.)
Gens
La majorité des gens appuient Périclès. En fait, la personne qui le critique le plus vivement est frappée d'ostracisme (bannie pendant dix ans) à la suite d'un jugement du peuple, rendant la construction possible.
Procession
La frise racontait l'histoire de la procession des Grandes Panathénées, un grand festival comprenant une procession et des jeux qui avait lieu à Athènes tous les quatre ans.
Panathénees
(Chaque année, lors des Petites Panathénees, on célébrait l'anniversaire de la déesse.) Pendant les Panathénées, on présentait à Athéna, qui était aussi la patronne des tisserands, un nouveau peplos (tunique) tissé par de jeunes filles.
Illustration
La frise illustrait la mise en route de la procession (côté ouest) et les participants à cette dernière (musiciens, cavaliers, prêtres, jeunes filles portant des offrandes, animaux destinés au sacrifice, etc.), qui longeait les côtés nord et sud de la cella, se dirigeant vers l'est. Sur le côté est, on voyait, assis, des dieux et des déesses et, debout, des autorités civiles et religieuses, qui se rassemblaient pour recevoir le nouveau vêtement et, naturellement, faire des discours.
Frontons
Le fronton ouest . Le Parthénon possédait deux frontons triangulaires, un sur chaque façade. Un élément courant des temples, le fronton présente des sculptures qui reflètent la vocation de l'édifice.
Concours
Le thème du fronton ouest du Parthénon était le concours mythologique entre Athéna et Poséidon pour déterminer qui protégerait Athènes.
Cadeau
Chacun offre un cadeau Poséidon, une source d'eau salée, symbole de la puissance maritime, et Athéna, un olivier, le peuple considère que le cadeau d'Athéna est plus pratique.
Olives
(Les olives sont appréciées comme denrée, et leur huile, utilisée dans les lampes, la cuisine et les cosmétiques, joue un rôle important dans les échanges.)
Figures
Athéna et son oncle, Poséidon, étaient les principales figures de cet ensemble de sculptures.
Personnages
Ils se trouvaient au centre du triangle, entourés de divers autres personnages : Cécrops, moitié homme, moitié serpent, le fondateur et premier roi d'Athènes; Érechthée, le deuxième roi; diverses divinités aquatiques; Hermès; Iris; etc.
Place
Le fronton est cet ensemble de sculptures occupait une place de choix où toute personne qui se rendait au temple par le chemin habituel pouvait le voir et l'apprécier en arrivant.
Naissance
Comme de juste, le thème de ce fronton était la naissance d'Athéna, à laquelle ont assisté les autres dieux et déesses.
Zeus
L'histoire est bien connue. Zeus a un mal de tête atroce et sent une grande pression dans la tête, qu'il n'arrive pas à réduire.
Héphaïstos
Il ordonne à son fils Héphaïstos de lui fendre la tête avec sa hache pour soulager les symptômes. De cette ouverture sort Athéna, adulte et tout armée. Au lieu du vagissement d'un nouveau-né, les témoins entendent un cri de guerre.
Événement
Cet évènement était commémoré en pierre sur le fronton. On voyait Zeus assis au centre, comme il se doit, accompagné des autres personnages principaux, Athéna et Héphaïstos, tandis que d'autres divinités assistaient à l'évènement miraculeux.

La déesse Artémis ajustant son chiton. Détail de la frise du Parthénon, panneau XIXX Copyright: Thomas Sakoulas, Ancient-Greece.org Used by permission of Ancient-Greece.org © 2001-2006.
Métopes
Le Parthénon avait en fait deux frises. La première, ornait l'extérieur. La deuxième, une frise dorique typique composée de triglyphes alternant avec des métopes, entourait l'extérieur de l'édifice, juste au-dessous du toit.
Triglyphe
Le triglyphe est un bloc comportant deux glyphes et deux demi-glyphes (des traits verticaux parallèles gravés en creux).
Parthénon
Il est moins large que la métope d'environ un tiers. Le Parthénon avait 92 métopes (32 sur chaque côté et 14 sur chaque façade), chacune mesurant environ 1,2 m 2.
Qualité
La qualité des métopes du Parthénon était de loin supérieure à celle des métopes qu'on trouve normalement sur les temples.
Décorées
Toutes les métopes étaient décorées, sculptées en haut-relief au point où certaines ressemblaient à des rondes-bosses, une histoire était racontée sur chaque côté de l'édifice.
Combat
Côté ouest (Amazonomachie) . Un combat entre les Grecs et les Amazones était présenté sur ce côté, dans la mythologie grecque, les Amazones sont une tribu belliqueuse de femmes descendantes d'Arès, le dieu de la guerre.
Conflit
Héraclès entre en conflit avec elles en exécutant ses douze travaux. Ce combat et les autres qui étaient illustrés symbolisent la victoire de la civilisation (les Grecs) sur les barbares (les Perses). Côté est (Gigantomachie). Le combat mythique entre les Géants et les dieux pour le contrôle de l'Olympe était illustré sur ce côté. Côté nord (la guerre de Troie).
Thème
Le thème de ce côté était la guerre de Troie, un thème de prédilection pour la décoration des temples et des vases. Côté sud (Centauromachie).
Chrétiens
Les premiers chrétiens ont sérieusement dégradé et défiguré les sculptures des trois autres côtés de l'édifice, mais celles du côté sud ont été épargnées.
Illustré
Personne ne sait pourquoi. Le combat mythique entre les Lapithes et les Centaures était illustré sur le côté sud. Ivres, les Centaures, qui avaient été invités à un mariage chez les Lapithes, ont essayé d'enlever les femmes de ces derniers.
Statue
La statue chryséléphantine d'Athéna. Cette œuvre d'art, imposante à tout point de vue, était d'une hauteur d'au moins 12 m, une figure impressionnante en or et en ivoire, les yeux incrustés de pierres précieuses, portant tout une panoplie d'armes et de symboles.
Chryséléphantine
Chryséléphantine est un mot d'origine grecque qui signifie « or (chryso) et ivoire (éléphantine) ». Il s'agit d'une technique courante en Grèce à l'époque classique. À une ossature en bois, on attachait de l'ivoire, représentant la chair, qu'on couvrait de vêtements en or battu.
Tyran Lacharès
L'or que comportait la statue d'Athéna est estimé à plusieurs millions de dollars. Selon des écrivains grecs de l'Antiquité, plus tard, le tyran Lacharès a dépouillé la déesse de son or pour payer son armée. Une tunique dorée aurait remplacé les vêtements d'origine.
Lance
Athéna tenait dans la main droite une figure de la Victoire ailée (Nikè) haute de 1,8 m. Dans la main gauche, elle avait une lance et son bouclier, à l'intérieur duquel se trouvait un serpent enroulé, représentant Érechthée, un des premiers rois d'Athènes. Ce dernier, fils de Gaïa, la déesse de la Terre, a été élevé par Athéna.
Achevé
Une fois le Parthénon achevé, Phidias construit une sculpture encore plus grande et plus renommée, la statue du dieu Zeus qui sera installée à Olympie.
Merveilles
Une des Sept Merveilles du monde antique, cette statue servira de modèle pour le Lincoln Memorial à Washington, D.C. Qu'est-ce qui est arrivé à la sculpture d'Athéna ?
Byzantins
Les Byzantins l'ont emportée à Constantinople avant le Ve siècle apr. J.-C. Puis elle a disparu, mais personne ne sait quand.
Symbole
Le rêve de Périclès, que le Parthénon soit un symbole impérissable de la grandeur d'Athènes et du triomphe inévitable de la civilisation sur les forces barbares, a été éphémère.
Achevées
Les dernières sculptures sont achevées en 432 av. J.-C., mais à peine trois ans plus tard, Périclès et nombre de ces concitoyens succombent à une horrible peste qui dévaste Athènes, le Parthénon sert de temple d'Athéna pendant un millénaire presque.
Moines
Puis, au VIe siècle apr. J.-C., des moines chrétiens de l'Église orthodoxe grecque prennent possession de l'édifice, qui devient l'église de la Sainte Sagesse (Hagia Sophia).
Chrétiens
Les chrétiens zélés cassent ou dégradent plusieurs sculptures qu'ils considèrent comme païennes ou profanes, et apportent des modifications mineures à l'architecture, sept cents ans s'écoulent.
 Athéna D'une hauteur de 12 m, ce colosse en or et en ivoire a coûté encore plus que l'édifice qui l'abritait. Courtesy MacGillivray Freeman Films.
Athéna D'une hauteur de 12 m, ce colosse en or et en ivoire a coûté encore plus que l'édifice qui l'abritait. Courtesy MacGillivray Freeman Films.
Francs
En 1204, les Français (les Francs) envahissent Athènes et prennent possession du Parthénon, qu'ils rebaptisent Notre-Dame d'Athènes. Le temple devient alors une église catholique.
Turcs
Dès 1458, les Turcs occupent Athènes et transforment le plus vite possible le temple ancien en mosquée islamique, y ajoutant un minaret.
Gouverneur
Le gouverneur turc installe son harem dans l'Érechthéion, le temple situé à côté du Parthénon (dont les colonnes ont la forme de caryatides, des figures féminines drapées à l'antique). En 1687, les Vénitiens, qui sont en guerre contre les Turcs, bombardent le Parthénon de boulets et d'obus de mortier.
Femmes
Convaincus que les Vénitiens n'attaqueraient pas le vénérable édifice religieux, les Turcs y avaient abrité leurs femmes et leurs enfants, ainsi que leur provision de poudre. Trois cents personnes et 28 colonnes du Parthénon périssent dans une immense explosion.
lord Elgin
Les activités de lord Elgin, homme d'État britannique et ambassadeur à Constantinople en 1801, auront également une incidence majeure sur le Parthénon.
Permission
Les autorités turques donnent à l'ambassadeur la permission de dessiner les merveilleuses sculptures, d'en prendre des moulages en plâtre et « d'emporter tout morceau de pierre portant des inscriptions ou des figures ». (De nombreuses morceaux de sculptures détruites dans l'explosion se trouvent encore dans les décombres du Parthénon.)
Morceaux
Les représentants de lord Elgin ne se contentent pas longtemps de ramasser des morceaux de sculptures brisées. Ils commencent à amputer l'édifice, se servant plus tard de scies pour enlever de gros morceaux de sculpture.
Cibles
Il faut dire à leur décharge qu'ils connaissent les autres pratiques destructrices de l'époque. Les Turcs ont utilisé des sculptures du Parthénon comme cibles dans des exercices de tir et ont décapité des figures qu'ils ont pu atteindre (celle de Périclès en était probablement une).
Chaux
De plus, les Turcs chaulent leurs bâtiments, dont bon nombre sont construits autour du Parthénon. Pour obtenir du blanc de chaux, on brûle du marbre, le réduisant en calcaire, puis on y ajoute de l'eau. Cette recette a mené à la destruction de statues brisées et intactes à Athènes et ailleurs.
 Des cavaliers dans la procession des Grandes Panathénées. Détail de la frise du Parthénon, panneau XIXX Copyright: Thomas Sakoulas, Ancient-Greece.org Used by permission of Ancient-Greece.org © 2001-2006.
Des cavaliers dans la procession des Grandes Panathénées. Détail de la frise du Parthénon, panneau XIXX Copyright: Thomas Sakoulas, Ancient-Greece.org Used by permission of Ancient-Greece.org © 2001-2006.
Vestiges
Aujourd'hui, les vestiges du Parthénon, les ossements blanchis de ce qui a été à un moment donné un chef-d'œuvre architectural pour tous les temps, témoignent silencieusement de la gloire de la Grèce antique.
Murs
Les sculptures qui ornaient les murs de marbre se trouvent aujourd'hui en morceaux, accrochés çà et là aux vestiges du temple ancien ou éparpillés à travers les grands musées du monde à Athènes, Londres, Paris, Munich, Rome, Copenhague, Vienne, etc.
Cassée
Au moins une des sculptures en marbre a été cassée et divisée entre trois grandes villes. La Grèce a adressé de nombreuses pétitions à la Grande-Bretagne lui demandant de restituer les marbres du Parthénon (dont environ 50 % se trouvent à Londres) parce que les Turcs n'avaient pas le droit de les distribuer à qui que ce soit.
Grande-Bretagne
La Grande-Bretagne refuse, disant que la collection a été obtenue légalement du gouvernement qui était alors au pouvoir et qu'elle n'a aucune intention de restituer quoi que ce soit. Voilà où en sont les choses.
Athènes
Bien qu'Athènes soit une ville qui a beaucoup à offrir à ses visiteurs, l'image qu'a certainement tout le monde en tête avant et après le voyage est celle du Parthénon. La vue sur l'imposant monument du Parthénon lors de la visite de l'Acropole est impressionnante et ne laisse personne indifférent.
Le mystère du Grand Sphinx
 Recréation par un artiste du Grand Sphinx et de la Grande Pyramide de Gizeh tels qu'ils apparaissaient probablement à l'époque de leur construction pendant la 4e dynastie d' Égypte (vers 2613-2498 avant notre ère).
Recréation par un artiste du Grand Sphinx et de la Grande Pyramide de Gizeh tels qu'ils apparaissaient probablement à l'époque de leur construction pendant la 4e dynastie d' Égypte (vers 2613-2498 avant notre ère).
Enseveli pendant la plus grande partie de sa vie sous le sable du désert, un air de mystère a toujours entouré le Grand Sphinx; mystère qui provoque des spéculations sur son âge et sa finalité, sa méthode de construction, ses chambres cachées, son rôle dans la prophétie et sa relation avec les pyramides tout aussi mystérieuses.
Théories
La plupart de ces théories font le désespoir des égyptologues et des archéologues, qui, raisonnablement me semble-t-il, n'accordent de crédit qu'aux théories étayées par des preuves tangibles.
Plateau
Faisant face au soleil levant, le Grand Sphinx est situé sur le plateau de Gizeh, à environ 10 km à l'ouest du Caire, sur la rive ouest du Nil. Plus tard, les souverains égyptiens le vénérèrent comme un aspect du dieu du soleil, l'appelant Hor-Em-Akhet ("Horus de l'horizon").
Sphinx
Le Sphinx se trouve dans une partie de la nécropole de l'ancienne Memphis, le siège du pouvoir des pharaons, à une courte distance de trois grandes pyramides. la Grande Pyramide de Khéops (Khoufou), Khéphren (Khafrê) et Mykérinos (Menkaourê).
Monument
Le monument est la plus grande sculpture conservée du monde antique, mesurant 73,5 m de long et 20 m de haut par endroits.
Manque
Il manque une partie de l'uræus (cobra sacré qui protégeait des forces maléfiques), le nez et la barbe rituelle ; la barbe est maintenant exposée au British Museum.
Extensions
Les extensions sur le côté de la tête font partie du couvre-chef royal. Bien que la tête du Sphinx ait été gravement endommagée par des milliers d'années d'érosion.
Traces
Des traces de la peinture originale sont encore visibles près d'une oreille. On pense qu'à l'origine, le visage du Sphinx était peint en rouge foncé. Un petit temple entre ses pattes contenait des dizaines de stèles inscrites placées par les pharaons en l'honneur du dieu Soleil.
Fouilles
Vers la fin de l'année 2010, lors de fouilles de routine dans la zone du monument, les archéologues égyptiens ont découvert de grandes sections de murs en briques crues qui faisaient partie d'un plus grand mur qui s'étendait sur 132 mètres (433 pieds) autour du Grand Sphinx.
Mur
Les archéologues pensent que le mur fut construit par Thoutmôsis IV après son rêve afin de protéger le Sphinx des vents du désert. Après le défrichage ordonné par Thoutmôsis IV, et malgré le mur, la sculpture colossale s'est à nouveau retrouvée sous le sable
Napoléon
Lorsque Napoléon arriva en Égypte en 1798, il trouva le Sphinx sans son nez. Des dessins datant du 18e siècle révèlent que le nez manquait bien avant l'arrivée de Napoléon ; une histoire veut qu'il ait été victime de tirs à la cible pendant la période turque.
Explication
Une autre explication, peut-être la plus probable, est qu'il fut coupé à coups de ciseaux au 8e siècle par un soufi qui considérait le Sphinx comme une idole sacrilège.
Sable
En 1858, une partie du sable entourant la sculpture fut dégagée par Auguste Mariette, le fondateur du Service des Antiquités Égyptiennes, et entre 1925 et 1936, l'ingénieur français Emile Baraize fouilla le Sphinx pour le compte du Service des Antiquités. Peut-être pour la première fois depuis l'Antiquité, le Grand Sphinx fut à nouveau exposé aux intempéries.
 Le Sphinx mesure 240 pieds de long (73 m) et 66 pieds de haut (20 m) orienté sur un axe droit d'ouest en est.
Le Sphinx mesure 240 pieds de long (73 m) et 66 pieds de haut (20 m) orienté sur un axe droit d'ouest en est.
Qui le Grand Sphinx représente-t-il ? L'explication de cette sculpture énigmatique, privilégiée par la plupart des égyptologues, est que Khéphren, un pharaon de la IVe dynastie, fit façonner la pierre en forme de lion avec son propre visage au moment de la construction de la pyramide de Khéphren située à proximité, vers 2540 avant notre ère.
Inscription
Cependant, aucune inscription n'identifie khéphren au Sphinx et aucune mention n'est faite de sa construction, ce qui est quelque peu surprenant au vu de la grandeur du monument.
Égyptologues
Malgré les affirmations contraires de nombreux égyptologues, personne ne sait avec certitude quand le Sphinx fut construit ni par qui. Le Sphinx a beaucoup souffert des ravages du temps, de l'homme et de la pollution moderne.
Sauvé
En fait, ce qui l'a sauvé de la destruction totale, c'est le fait qu'il ait été enseveli sous le sable du désert pendant la majeure partie de sa vie.
Restauration
Il y eut plusieurs tentatives de restauration du Grand Sphinx au cours des millénaires, à commencer vers 1400 av. J.-C. par le pharaon Thoutmôsis IV.
Endormi
Après s'être endormi à l'ombre du Sphinx lors d'une partie de chasse, le pharaon rêva que la grande bête s'étouffait à cause du sable qui l'engloutissait et qu'elle lui disait que s'il dégageait le sable, il obtiendrait la couronne de Haute et de Basse-Égypte.
Stèle
Entre les pattes avant du Sphinx se trouve une stèle en granit, aujourd'hui appelée "stèle du rêve", sur laquelle est inscrite l'histoire du rêve du pharaon.
Visage
En 1996, un détective new-yorkais et expert en identification a conclu que le visage du Grand sphinx ne correspondait pas aux représentations connues du visage de Khéphren. Il a soutenu qu'il y avait une plus grande ressemblance avec le frère aîné de khéphren, Djédefrê.
Mystère
Le mystère de l'origine et de la finalité du Sphinx a souvent donné lieu à des interprétations mystiques, comme celles de l'occultiste anglais Paul Brunton et, dans les années 1940, du médium et prophète américain controversé Edgar Cayce.
Taillé
Le Grand Sphinx a été taillé dans un calcaire naturel relativement tendre provenant de la carrière utilisée pour la construction des pyramides ; les pattes avant ont été fabriquées séparément à partir de blocs de calcaire. L'une des principales bizarreries de cette sculpture est que la tête est disproportionnée par rapport au corps.
Tête
Il est possible que la tête ait été sculptée à plusieurs reprises par les pharaons successifs depuis la création du premier visage, bien que, pour des raisons stylistiques, il soit peu probable que cela ait été fait après la période de l'Ancien Empire en Égypte (qui se termina vers 2181 av. J.-C.).
Bélier
La tête originale était peut-être celle d'un bélier ou d'un faucon et aurait été redécoupée en forme humaine par la suite.
Réparations
Les diverses réparations effectuées sur la tête endommagée pendant des milliers d'années ont pu réduire ou modifier les proportions du visage.
Explications
Chacune de ces explications pourrait expliquer la petite taille de la tête par rapport au corps, en particulier si le Grand Sphinx est plus ancien que ce que l'on croit traditionnellement.
 Le Grand Sphinx de Gizeh.
Le Grand Sphinx de Gizeh.
Datation
La datation du monument a fait l'objet de vifs débats ces dernières années. L'auteur John Anthony West a remarqué pour la première fois des formes d'altération sur le Sphinx qui correspondaient à une érosion par l'eau plutôt que par le vent et le sable.
Robert Schoch
Ces motifs semblaient particuliers au Sphinx et ne se retrouvaient pas sur d'autres structures du plateau. West a fait appel à Robert Schoch, géologue et professeur à l'Université de Boston, qui, après avoir examiné les nouvelles découvertes, a convenu qu'il y avait des preuves d'érosion par l'eau. Bien que l'Égypte soit aride aujourd'hui, il y a environ 10 000 ans, la terre était humide et pluvieuse.
Conclu
Par conséquent, West et Schoch en ont conclu que pour avoir les effets de l'érosion hydrique qu'ils ont trouvés, le Sphinx devrait avoir entre 7 000 et 10 000 ans.
Théorie
Les égyptologues ont rejeté la théorie de Schoch comme étant grossièrement imparfaite, soulignant que les grandes tempêtes de pluie autrefois répandues en Égypte avaient cessé bien avant la construction du Sphinx.
Érosion
Plus sérieusement, pourquoi n'a-t-on pas trouvé d'autres signes d'érosion hydrique sur le plateau de Gizeh pour valider la théorie de West et de Schoch ?
Pluie
La pluie n'a pas pu se limiter à ce seul monument. West et Schoch ont également été critiqués pour avoir ignoré le niveau élevé de pollution atmosphérique industrielle locale au cours du siècle dernier qui a gravement endommagé les monuments de Gizeh.
Robert Bauval
Un autre auteur, Robert Bauval, a sa propre théorie sur la date du Sphinx. Bauval a publié un article en 1989 montrant que les trois grandes pyramides de Gizeh, et leur position relative par rapport au Nil, "formaient une sorte d'hologramme" en 3D sur le sol, des trois étoiles de la ceinture d'Orion et de leur position relative par rapport à la Voie lactée.
Graham Hancock
Avec Graham Hancock, auteur de Fingerprints of the Gods, Bauval a développé une théorie élaborée selon laquelle le Sphinx, ses pyramides voisines et diverses écritures anciennes constituent une sorte de carte astronomique liée à la constellation d'Orion.
Conclusion
Leur conclusion est que la meilleure correspondance pour cette carte hypothétique est la position des étoiles en 10 500 avant notre ère, ce qui repousse encore plus loin dans le temps l'origine du Sphinx.
Date
Cette date est naturellement contestée par les égyptologues, car aucun artefact archéologique datant de cette période n'a jamais été découvert dans la région.
Légendes
Il existe plusieurs légendes de passages secrets associés au Grand Sphinx. Des enquêtes menées par l'Université d'État de Floride, l'Université de Waseda au Japon et l'Université de Boston ont permis de repérer diverses anomalies dans la zone entourant le monument, bien qu'il puisse s'agir de caractéristiques naturelles.
Ouvriers
En 1995, des ouvriers rénovant un parking voisin ont découvert une série de tunnels et de chemins près du Sphinx, dont deux plongent plus loin sous terre.
Contemporains
Robert Bauval pense qu'ils sont contemporains du Sphinx lui-même. Entre 1991 et 1993, alors qu'elle examinait les preuves de l'érosion du monument à l'aide d'un sismographe, l'équipe d'Anthony West a découvert des anomalies sous la forme d'espaces ou de chambres creuses de forme régulière, à quelques mètres sous terre, entre les pattes et de chaque côté du Sphinx.
Statue
Aujourd'hui, la grande statue s'effrite à cause du vent, de l'humidité et du smog du Caire.
Projet
Un énorme et coûteux projet de restauration et de préservation est en cours depuis 1950, mais au début de ce projet, du ciment a été utilisé pour les réparations, ce qui était incompatible avec le calcaire et a donc causé des dommages supplémentaires à la structure.
Blocs
Sur une période de 6 ans, plus de 2 000 blocs de calcaire ont été ajoutés à la structure et des produits chimiques y ont été injectés, mais le traitement a échoué.
Détérioration
En 1988 l'épaule gauche du sphinx était dans un tel état de détérioration que des blocs tombaient. À ce jour la restauration est toujours un projet en cours sous le contrôle du Conseil suprême des antiquités qui effectue des réparations sur l'épaule endommagée et tente de drainer une partie du sous-sol.
Secrets
Par conséquent, l'accent est mis aujourd'hui sur la préservation plutôt que sur de nouvelles explorations ou fouilles, il faudra donc attendre encore longtemps avant que le Grand Sphinx ne nous livre ses secrets.
Le monstre du Loch Ness
 Photo montage du monstre du Loch Ness.
Photo montage du monstre du Loch Ness.
L’Écosse, ses châteaux hantés, ses catacombes et leurs fantômes, ses territoires sauvages et…le monstre du loch Ness !
Créatures
Si l’Écosse nous offre de nombreuses créatures fantastiques issues de ses légendes, Nessie (ou Nessy), le fameux monstre du loch du Ness, est l’un des plus célèbres du monde.
Touristes
Chaque année, de nombreux touristes espèrent tomber nez à nez avec l’animal, dans le mythique lac des Highlands. L’histoire du monstre remonte à plus de 1 500 ans. Mais c’est véritablement au début du XXe siècle que son succès est devenu planétaire et que l’animal a commencé à provoquer toutes les spéculations sur son existence.
 Tout est parti de ce cliché publié dans les colonnes du Daily Mail le 21 avril 1934, dont l’auteur a plus tard avoué qu’il s’agissait d’une photo truquée… SIPA.
Tout est parti de ce cliché publié dans les colonnes du Daily Mail le 21 avril 1934, dont l’auteur a plus tard avoué qu’il s’agissait d’une photo truquée… SIPA.
Photo
En 1934, une photo donnait un rayonnement mondial à cette créature légendaire. Depuis, les théories se multiplient, malgré une nouvelle étude scientifique qui met à mal celle d’un véritable monstre.
Amis
Deux amis, dont un médecin anglais, se promènent au bord d’un lac écossais. Alors qu’ils se tournent vers le lac, surgit avec grâce, du fond des eaux, une créature gigantesque à tête de serpent de mer et au long cou de dinosaure.
Robert Kenneth Wilson
L’un des deux hommes, Robert Kenneth Wilson, prend alors une photo. Elle fait vite le tour du monde. Elle est publiée dans le Daily Mail et interpelle des personnes de tous les pays. C’est la première image du monstre du Loch Ness.
Cliché
C'est un simple cliché publié dans les colonnes du Daily Mail, le 21 avril 1934, qui fera de Nessiterras Rhombopteryx, surnommé Nessie, une star planétaire.
Auteur
Son auteur, Robert Kenneth Wilson, un chirurgien londonien en excursion aux abords du lac écossais, raconte avoir vu « les eaux enfler soudainement et un étrange animal émerger un court instant, à 200 mètres du rivage ».
Truquée
Peu importe que son auteur révèle, des années plus tard, que la photo était truquée, le monstre du Loch Ness entre dans l'histoire.
Moine
Mais Nessie n'a pas attendu d'être « photographié » pour faire parler de lui. Bien au contraire, ce monstre marin aurait été aperçu pour la première fois par le moine irlandais Saint Columba, en l'an 565 dans la rivière Ness, qui relie le Loch à la mer du Nord.
Alex Campbell
Après la crise de 1929, le Loch Ness, jusque-là très prisé des touristes, se déserte. Alex Campbell, le correspondant de l'Inverness Courrier, un journal local, décide d'écrire un article sur le monstre évoluant dans les eaux sombres et froides du lac, dont lui parlait sa grand-mère.
Folklore
Il s'agirait d'un kelpie, une créature issue du folklore écossais revêtant les traits d'un cheval marin. « À ce moment-là, King Kong sort en salles, avec son Brontosaurus. Il se forme une sorte de contagion dans l'esprit des gens, entre l'image du dinosaure et celle du kelpie » .
Imaginaire
« L'imaginaire du grand public fait le reste », explique Anne Van de Winkel, docteur en information et communication et spécialiste des légendes urbaines.
Légende
La légende traditionnelle du monstre est remise au goût du jour, et les touristes reviennent au Loch Ness. Les photos et les témoignages se multiplient. Les riverains du lac contribuent également à alimenter le mythe. L'un d'entre eux explique, dans son testament, avoir sculpté un monstre en bois, qu'il s'amusait sortir régulièrement.
Bob Stewart
En mars 2018, Bob Stewart, un député conservateur britannique affirme que Nessie a été inventé de toutes pièces par son grand-oncle… pour un retard à l'école.
Monstre
"Lui et un autre garçon ont affirmé qu'ils étaient en retard parce qu'ils venaient de voir le monstre du Loch Ness, a-t-il assuré au Daily Mail".
Histoire
"L'histoire a pris des proportions incroyables. Il n'a jamais pu dire que c'était faux. Ce n'est qu'à ses funérailles que mon oncle a déclaré que son père n'avait jamais vu le monstre du Loch Ness et qu'il l'avait créé de toutes pièces".
Bête
On ne retrouve aucune description si ce n’est que la créature avait surgi du lac en rugissant. On sait également que la bête aurait attaqué deux de ses compagnons ce jour-là. Le moine irlandais aurait été sauvé de ses assauts et aurait fait fuir la créature lacustre grâce à un signe de la croix. Or les saints ont la réputation d’être sincères, ce qui a convaincu du monde.
Habitants
De nombreux siècles plus tard, en 1933, des habitants proches du lac affirment avoir vu un animal énorme rouler sur le lac et y plonger.
Événement
Cet événement, suivi de la photo de Robert Kenneth Wilson, vont faire éclater les hypothèses et théories les plus étranges et extravagantes sur la mystérieuse bête.
Crédible
C’est d’autant plus crédible que le médecin photographe est un vétéran de la première guerre mondiale et qu’il a été décoré. On ne peut donc pas vraiment le taxer de fantaisiste !
Nessy
Le monstre, un supposé Nessiterras Rhombopteryx, est vite surnommé Nessy et les témoignages sont pris au sérieux.
 Le loch Ness vu du sud en mai 2006.
Le loch Ness vu du sud en mai 2006.
Squelette
En 2018, les images du squelette d’un animal mystérieux ont fait le tour des réseaux sociaux. De nombreux internautes ont émis l’hypothèse qu’il s’agissait des os de Nessie. En effet, le monstre marin se serait échoué sur une plage de sable anglaise, non loin du Loch Ness.
Carcasse
La carcasse présentait un long cou, mais des intestins encore frais. Plusieurs sceptiques ont alors objecté que les boyaux auraient dû pourrir avant le reste, la décomposition d’un animal se produisant dans un certain ordre.
Supercherie
D’autres ont jugé que l’aspect intact de l’ensemble des os n’était pas, non plus, réaliste. Finalement, la supercherie a été admise et reconnue par le journal qui avait publié les photos, le monstre marin n’est donc, a priori, pas encore mort !
ADN
En 2018, une équipe de chercheurs scientifiques a analysé les eaux du lac, notamment l’ADN, afin d’étudier la présence de vie dans cet environnement.
Liste
Une fois la liste établie de toutes les espèces animales capables de s’acclimater au loch, un scientifique de Nouvelle-Zélande, Neil Gemmell, a conclu que le monstre pouvait être une anguille géante.
Plésiosaure
Les 2 ans d’analyse ont mis à mal la théorie selon laquelle il était un plésiosaure, c’est-à-dire un reptile marin provenant de la préhistoire.
Anguille
C’est l’ADN de l’anguille que l’on retrouve le plus dans l’analyse de l’eau du lac. A priori, l’anguille n’étant pas un animal agressif, c’est même un poisson inoffensif, on pourrait en déduire que Nessie n’est pas dangereux, mais les attaques qu’il aurait commises en 565 laissent planer le doute !
Ombre
Puis en 2022, des touristes relancent les spéculations avec leurs témoignages : un couple de quinquagénaires se balade sur les bords du lac et aperçoit une ombre vers le milieu.
Bosses
Ils filment et postent la vidéo sur Twitter. Celle-ci montre des bosses qui surgissent de l’eau. Gary Campbell, qui traque Nessie depuis 25 ans, affirme qu’il s’agit de la meilleure séquence observée, après avoir étudié plus 1 000 observations.
Une autre photo, de Google cette fois-ci, dans son application Street View Aquatique, montre une forme de branche qui serait le mode de camouflage utilisé par Nessie.
Explorer
Il est donc maintenant possible d’explorer le loch depuis son ordinateur ou sa tablette et d’observer la surface de l’eau pour trouver des signes de la présence de la créature.
Aventuriers
Des aventuriers du monde entier peuvent aujourd’hui poursuivre leur quête du monstre depuis chez eux à la recherche d’un indice concluant.
Argentine
Le saviez-vous ? Il existerait d’autres monstres semblables à Nessie, notamment en Argentine dans le lac Nahuel Huapi où on le qualifierait « Nahuelito », et au Congo où il serait appelé le Mokele-mbembe.
Témoignage
Un randonneur, pilote de drone, a peut-être capturé une nouvelle image de Nessie, apportant un nouveau témoignage de l'existence du monstre du Loch Ness.
Richard Mavor
L'Histoire remonte à l'été 2021. Richard Mavor se trouvait sur les rives du Loch quand il a sorti son drone pour filmer quelques séquences pendant son périple. Sans s'en rendre compte, il aurait en effet accidentellement capturé la silhouette sombre nageant sur les rives du loch le mois dernier.
YouTube
Ce n'est qu'après avoir téléchargé des images sur sa chaîne YouTube que des abonnés ont remarqué cette étrange forme sous l'eau.
Eaux
Dans les eaux troubles, les internautes ont ainsi repéré depuis le plan aérien une mystérieuse "créature" sous l'eau dans la dernière vidéo partagée par @RichardOutdoors.
Série
Cet aperçu fait suite à une série de témoignages relevés pendant l'été dans le plus célèbre des Highlands, avec cinq nouvelles observations ajoutées au registre officiel des observations du monstre du Loch Ness.
Randonneur
Selon le randonneur qui avait participé ce jour-là à une course de kayak au profit d'une association de lutte contre la maladie d'Alzheimer.
Forme
Il a déclaré qu'il n'avait pas remarqué la forme inhabituelle apparaissant dans l'eau jusqu'à ce que des abonnés de sa chaîne commencent à commenter la vidéo.
 La créature photographiée ici dépasse les 2,5 mètres. © Steve Challice/Cover Images/ABACAPRESS.COM.
La créature photographiée ici dépasse les 2,5 mètres. © Steve Challice/Cover Images/ABACAPRESS.COM.
Album
De nouvelles photos viennent d’être ajoutées à l’album de famille de Nessie, le monstre du Loch Ness. Si parmi les centaines de clichés de la légendaire créature, beaucoup, dont le tout premier pris en 1934, se sont avérés des trucages plus ou moins habiles, quelques-uns conservent encore une part de mystère.
Steve Challice
Est-ce le cas de ces quatre photos prises en septembre dernier par Steve Challice, un Anglais originaire de Southampton ?
Remous
Alors qu’il se trouvait près du château d’Urquhart sur la rive ouest du lac, Steve a aperçu des remous à la surface des eaux calmes du lac. « J’ai pris une première photo, puis une deuxième, et soudain, c’est sorti de l’eau et j’ai pu capter cet instant.»
Silure
Le Britannique garde son flegme : « selon moi, et je ne suis pas un expert, il s’agit simplement d’un très gros poisson, peut-être un énorme silure. »
Esturgeon
« Quelqu’un a suggéré que ce pourrait être un esturgeon. Ce que l’on peut voir de cette bête à la surface mesure près de 2,5 mètres, mais il n’est pas impossible que la partie immergée dépasse cette taille. Difficile à dire tant les eaux du Loch Ness sont sombres.».
Hypothèses
Les hypothèses de Steve Challice n’ont rien d’aberrant : le silure glane peut atteindre 2,75 mètres et on en trouve en Écosse. Quant à l’esturgeon d’Europe, il peut lui aussi atteindre, voire dépasser, les trois mètres. Bien qu’il vive en partie en mer et se reproduise dans les fleuves, il n’est pas impossible d’en retrouver égarés dans des lacs.
Poissons
Ces deux poissons aux dimensions démesurées et à l’aspect étrange figurent depuis longtemps parmi les principaux candidats à l’identité secrète de Nessie, ces photos apportent de l’eau au moulin des tenants de cette explication.
La tombe de Toutânkhamon (TUT ANKH AMUN)
 Photographie de pgaborphotos, istock via getty images.
Photographie de pgaborphotos, istock via getty images.
Du masque en or de Toutânkhamon, Carter écrivait : « contrastant avec la couleur sombre du corps, un magnifique masque d’or brillant, représentant le visage du pharaon, couvrait la tête et les épaules.»
Jeunesse surprise par la mort
« Le masque d’or, spécimen unique de l’art antique, avait une expression triste, mais calme, suggérant la jeunesse prématurément surprise par la mort. »
Howard Carter
Le 4 novembre 1922, Howard Carter est sur le point de renoncer à trouver la tombe de Toutânkhamon, lorsque son équipe met au jour un escalier… Retour sur l’une des découvertes les plus spectaculaires de l’égyptologie.
Récit
Le récit d’Howard Carter, qui mit au jour la tombe de Toutânkhamon, ce pharaon obscur du Nouvel Empire (1335-1327 av. J. C), est entré dans la légende des grandes découvertes archéologiques.
Vallée des Rois
Ce modeste hypogée, niché dans les plis protecteurs de la Vallée des Rois, allait dévoiler aux yeux du monde plus de 5 000 objets d’un prodigieux trousseau funéraire.
Égypte ancienne
Et éclairer les événements d’une XVIIIe dynastie finissante, l’une des époques les plus commentées de l’Égypte ancienne.
Comte de Carnarvon
Grâce au soutien du 5e comte de Carnarvon, qui a obtenu une concession dans la nécropole thébaine, Carter, professionnel scrupuleux et pugnace, cherche depuis 1917 une tombe inconnue au cœur de la Vallée des Rois.
Toutânkhamon
Le nom de Toutânkhamon, apparu à plusieurs reprises sur des objets et des inscriptions, le poursuit.
Recherches infructueuses
Mais, jusqu’à ce mois de novembre 1922, ses recherches sont restées infructueuses ; son mécène lui annonce que cette saison de fouilles sera la dernière qu’il financera.

Photographie de BPK & Scala & Florence. Howard Carter et son équipe enveloppent soigneusement l'une des deux statues sentinelles de l'antichambre avant de la sortir du tombeau.
Zone
Le 3 novembre, déterminé, l’archéologue s’attaque à une zone peu explorée de la Vallée : celle des vestiges de cabanes qui abritaient les ouvriers de la tombe de Ramsès VI. Le lendemain matin, lorsqu’il arrive sur le site, « un silence inhabituel » l’accueille.
Porteur d’eau
Le petit porteur d’eau qui abreuve les ouvriers, en enfonçant sa jarre dans le sable, a révélé une marche taillée dans le roc… Carter, pour l’heure, refuse de s’abandonner à un quelconque enthousiasme, qu’il juge prématuré.
Escalier
Pourtant, à mesure que son équipe déblaie les marches, c’est tout un escalier qui se dessine : il mène à l’entrée d’une tombe, mais celle-ci a pu être pillée dans l’Antiquité, comme la plupart des grands hypogées de la Vallée…
Crépuscule
Au crépuscule de ce jour béni des dieux, alors que la 12e marche est dégagée, surgit la partie supérieure d’une porte scellée.
Vrai
« c’était donc vrai s'écrira Carter, des années de patient travail allaient enfin être récompensées ! »
Enterré
« J’avais eu raison de ne pas perdre foi en la Vallée. Fébrilement, je cherchai sur la porte quelque chose qui pût me dire qui était enterré là, mais je ne pus voir que les sceaux distinctifs de la nécropole royale : Anubis dominant les neuf ennemis de l’Égypte. »
Personnage
Cette représentation traditionnelle indique qu’un personnage de haut rang a bien été inhumé ici. Dissimulée par les cabanes des ouvriers, cette tombe pourrait-elle être intacte ?
Minute rare
« Minute rare dans la vie d’un fouilleur » , poursuit l’archéologue. « Seul avec mes ouvriers, je me trouvais peut-être, après des années de labeur relativement improductif, au seuil d’une importante découverte. »
Couloir
« Ce couloir pouvait, littéralement, mener à tout. Et je dus faire un immense effort pour me retenir d’abattre la porte sur-le-champ. »
Patienter
« Tout seigneur tout honneur » : le lord Carnarvon est en Angleterre, et Carter doit encore patienter jusqu’à l’arrivée de son mécène et alter ego.
Télégramme
Le 6 novembre, le comte reçoit un télégramme qui le plonge dans une véritable béatitude : « Merveilleuse découverte dans la Vallée. Tombe superbe avec sceaux intacts. »
Attends votre arrivée
« Attends votre arrivée pour ouvrir. Félicitations », le 23 novembre, il arrive à Louxor avec sa fille lady Evelyn Herbert.
Postérité
Quelques jours plus tard, en pénétrant dans la tombe de Toutânkhamon, tous trois entrent dans la postérité et, en même temps, redonnent vie à un jeune roi mort à seulement 17 ans.
Heure enfin venue
Vallée des Rois, 26 novembre 1922, fin d’après-midi. Devant la porte se tiennent Carter, l’ingénieur Arthur Callender, lord Carnarvon et lady Evelyn. L’heure est enfin venue de pénétrer dans la tombe.
Lieux déjà visités
Hélas, des signes montrent que les lieux ont déjà été visités par le passé : sur le mur, au pied de l’escalier, ils détectent des traces d’effraction ; des ouvertures ont été refermées et plâtrées, et de nouveaux sceaux, apposés.
Doute
À ce moment précis, Carter, cet esprit méthodique, qui a rassemblé pendant des années les moindres, indices de la présence de la tombe de Toutânkhamon dans la Vallée des Rois, est-il taraudé par le doute ?
Fragments d’objets
La porte abattue, un couloir en pente révèle des gravats mêlés à des fragments d’objets : les voleurs, dérangés au cours de leur effraction, les ont abandonnés derrière eux.
Nom du roi-adolescent
Les ouvriers déblaient la galerie inclinée qui s’enfonce dans la tombe. En fin d’après-midi, l’équipe arrive devant une deuxième porte qui mentionne, divine surprise, le nom du roi-adolescent.
Trousseau funéraire d’un roi
Carter y pratique une petite ouverture et avance une bougie. Devant ses yeux incrédules, se dessinent les contours d’un bestiaire fantastique, un prodigieux bric-à-brac mêlant statues, meubles et chars, tous très bien conservés : le trousseau funéraire d’un roi.
 Photographie de Araldo de Luca.
Photographie de Araldo de Luca.
Tombeau
Le tombeau en or massif mis au jour par Carter contenait deux autres sanctuaires. Il a fallu plus d'un an pour les séparer et révéler un énorme sarcophage en quartzite.
Version officielle
La version officielle stipule que les quatre découvreurs se contentent d’un regard, referment l’ouverture pratiquée et remontent à l’air libre.
Sources
Cependant, certaines sources ont montré que le trou a été suffisamment agrandi pour qu’ils aient pu entrer un à un dans la tombe.
Atmosphère ineffable
Dans l’antichambre règne une atmosphère ineffable : personne n’a pénétré dans ces lieux depuis l’Antiquité ; des parfums y flottent encore, des fleurs ont été déposées par une main féminine.
Artefacts
Et partout des artefacts somptueux, serrés les uns contre les autres, comme ces lits funéraires à tête d’animaux ou ce trône doré enveloppé dans du lin noir, que Carter qualifiera de « plus belles choses qu’(il a.) jamais vue en Égypte ».
Porte murée
Deux statues noir et or à l’effigie du roi, dont le regard de calcite et d’obsidienne semble ouvrir fixer ces modernes intrus, veillent devant une porte murée.
Chambre funéraire
Pourrait-elle cacher la chambre funéraire de Toutânkhamon ?
Ouverture
Sans hésiter, Carter descelle les blocs d’une ouverture qui a été rebouchée après le forfait des voleurs et se glisse jusqu’au sol d’un étroit passage.
Mur d’or
Il reste pétrifié : devant lui se dresse un mur d’or, qui se révèle être une imposante chapelle en bois doré. Il vient de pénétrer dans la chambre funéraire du roi.
Deuxième porte
Des dizaines de marguerites de bronze doré laissent apparaître une deuxième porte. Une corde tressée relie les sceaux de la nécropole royale intacts, cette fois.
Inviolées
Les chapelles abritant le sarcophage et la dépouille de Toutânkhamon seraient donc inviolées…
Salle du trésor
Dans l’angle nord-est de la chambre funéraire, sa lampe révèle une petite pièce, la « salle du trésor », où trône la statue du dieu-chacal Anubis.
Chapelle en bois doré
Derrière le hiératique gardien de l’au-delà, se dessine une chapelle en bois doré, abritant les vases canopes aux viscères du roi et protégée sur ses quatre faces par des déesses au corps gracile.
Exploration
Mais cette exploration est illicite, et il ne faut pas attirer l’attention ni les foudres du service des Antiquités égyptiennes avant la visite officielle des autorités.
Carter
Carter dépose donc une grande corbeille en osier et une botte de roseaux pour dissimuler l’ouverture qu’il a pratiquée dans la porte menant à la chambre funéraire.
Collectionneur
Ce collectionneur averti a conscience de vivre « le jour entre les jours, le plus merveilleux qu’il lui ait été donné de vivre, et qui restera inégalé ».
 Photographie de Fernando Aznar.
Photographie de Fernando Aznar.
Antichambre
Carter fut étonné de voir pour la première fois l'antichambre : "C'était un spectacle qui surpassait tout ce que j'avais pu voir précédemment, et tout ce que nous avions rêvé de voir."
Pillé
Le tombeau avait été partiellement pillé en des temps reculés, mais il restait dans le tombeau un grand nombre d'objets.
10 années
Il ne sait pas encore qu’il lui faudra 10 éprouvantes années pour dégager la tombe numérotée KV62, et pour classer, étudier, restaurer ses 5 398 objets.
Difficultés
L’euphorie retombée, les difficultés se multiplient. Le service des Antiquités égyptiennes modifie les règles juridiques concernant le partage des objets issus de fouilles. Finis le « 50/50 » entre l’État et les fouilleurs : désormais, on choisira, au bénéfice de l’Égyptee, tout ou partie des découvertes.
Fonds
Il comptait récupérer une partie des fonds qu’il avait engagés durant toutes ces années.
Times
Par ailleurs, en accordant l’exclusivité des droits au Times contre un contrat très avantageux, il s’aliène aussi la presse internationale.
Solutions
Confronté à mille difficultés, Carter doit quant à lui inventer sans cesse des solutions pour restaurer ces objets d’une valeur inestimable.
Spécialistes
Face à ce défi de taille, il en appelle aux meilleurs spécialistes : son assistant Callender, le conservateur Arthur Mace, le chimiste Alfred Lucas, les épigraphistes sir Alan Gardiner et Henry Breasted.
Harry Burton
Quant aux photos d’Harry Burton, elles seront une source précieuse de renseignements sur l’ordonnancement de la tombe et contribueront largement au rayonnement et à la légende du jeune roi.
Inventaire
Sans cesse dérangé par d’illustres visiteurs et pris dans ses démêlés avec les autorités, Carter, dont le caractère peu diplomate a toujours joué poursuit tant bien que mal son délicat inventaire.
Entrepôt
La tombe de Séthi II, abritée par la falaise des ardeurs du soleil, sert d’entrepôt et de laboratoire photographique.
Crépitement des flashs
La distance qui sépare les deux hypogées permet aux touristes et à la presse d’assister au spectaculaire défilé des artefacts, sous les applaudissements et le crépitement des flashs.
500 objets
En mai 1923, les 500 objets de la seule antichambre sont acheminés par le Nil vers la capitale et exposés au Musée égyptien du Caire.
Carnarvon mort
Un mois, plus tôt, Carnarvon est mort : son décès soit disant inexpliqué déclenchera le mythe de la « malédiction » de la tombe, dont le lord aurait été la première victime pour avoir dérangé le sommeil éternel de Toutânkhamon !
Masque funéraire
Sur la tête et les épaules de la momie avait été placé l'un des plus grands trésors du monde et peut-être la découverte la plus célèbre du tombeau : le masque funéraire en or massif de Toutânkhamon.
 Photographie de BPK & Scala & Florence.
Photographie de BPK & Scala & Florence.
Démonter
La saison de fouilles de 1924 permet de démonter les chapelles funéraires : la première en révèle trois autres, en bois plaqué d’or incrusté de faïence aux motifs de piliers djed (la stabilité, associée à Osiris) et de nœuds tit (symbole d’Isis).
Somptueux sarcophage
Le 3 janvier 1924, Carter tire les verrous de la quatrième chapelle : elle dévoile un somptueux sarcophage de quartzite jaune doré.
Isis Nephtys Selkis et Neith
Les déesses protectrices du défunt, Isis, Nephtys, Selkis et Neith, en occupent chacune l’un des quatre angles, le visage tourné vers le chevet du roi, leurs ailes déployées autour de son corps osirifié.
Sarcophage de 1 250 kilos
Le 12 février 1924, on sangle fermement la dalle du sarcophage en granit rouge de 1 250 kilos et l’on actionne le système de levage : le premier cercueil en bois doré surgit de son sommeil éternel.
Symboles
L’Osiris-Toutânkhamon arbore les symboles de la royauté : la crosse et le flagellum.
Couvercle
Un an plus tard, le couvercle du cercueil extérieur est ôté, puis le deuxième, recouvert de feuilles d’or incrustées de pâte de verre imitant le jaspe rouge, le lapis-lazuli et la turquoise.
110 kilos d’or massif
Le troisième cercueil, pesant 110 kilos d’or massif, porte des reliefs figurant les déesses Isis, Nephtys, Nekhbet et Ouadjet, le tout rehaussé de pierres, de pâte de verre et de faïence.
 Photographie de BPK & Scala & Florence.
Photographie de BPK & Scala & Florence.
Uu pharaon sorti de l'anonymat
À l'intérieur du sarcophage, se trouvait un cercueil, et à l'intérieur, il y en avait deux de plus, imbriqués l'un dans l'autre, comme des poupées russes.
Toutânkhamon
La « rencontre » tant attendue par Carter se profile enfin. Linceuls noircis, onguents dégradés : de cet amas poisseux, émerge soudain du légendaire masque d’or poli à l’image du roi, qui couvre la tête, les épaules et la poitrine de la momie de Toutânkhamon.
Bandelettes
Entre les différentes couches de bandelettes, 143 pièces d’orfèvrerie amulettes protectrices, bijoux sont mises au jour.
Transfert
Lors de la saison 1926-1927, Carter aborde enfin la « salle du trésor » et commence le transfert de ses merveilles.
Tombe ouverte au public
Le 8 janvier 1928, la tombe est ouverte. En février 1932, les derniers objets sont envoyés au Musée égyptien du Caire.
KV62
Ce que le découvreur de la KV62 a accompli est considérable : trier, décrire, dessiner, numéroter et conserver des chefs-d’œuvre uniques, extraordinairement précieux et fragiles.
The Tomb of Tut-AnkhAmen
Ce formidable archéologue autodidacte, qui publiera un beau livre de vulgarisation en trois volumes, The Tomb of Tut-AnkhAmen, mais ne parviendra jamais à écrire le grand ouvrage scientifique qu’il ambitionnait, s’éteint en Angleterre le 2 mars 1939.
Découverte
Grâce à cette fabuleuse découverte, Toutânkhamon, le roi-adolescent dont ses successeurs avaient fait disparaître jusqu’au nom, le vouant ainsi au néant, l’icône absolue de l’Égypte ancienne.
Trésor
L’intégralité du trésor de ce pharaon est présentée dans le Grand Musée d’Égypte, à Gizeh.
Demeure d’éternité
Sa momie repose quant à elle sous un linceul immaculé, dans sa « Demeure d’éternité » de la Vallée des Rois, témoignage de ce souverain réhabilité grâce à une magistrale quête archéologique.
Un lac sous la colline de Fourvière à Lyon : légende ou réalité ?

À Lyon, lorsque l’on se promène dans le quartier de Saint-Jean dans le 5e arrondissement, on peut entendre parler d’un supposé lac sous Fourvière.
300 mètres d'altitude
Depuis ses origines, la cité a grandi autour de Fourvière. Elle s’est développée à son sommet, au temps des Romains, puis à ses pieds, au Moyen-Âge, avec l’émergence du Vieux-Lyon. Ses flancs ont posé plus de problèmes.
Petite montagne
Cette petite montagne culminant à 300 mètres d’altitude, la ville a toujours tenté de l’apprivoiser sans jamais parvenir à la dompter. La série d’incidents survenus au fil des siècles est là pour le rappeler.
Colline
Alors, qu’y a-t-il vraiment sous la colline ? Ce lac, a-t-il réellement existé ? Existe-t-il encore ? La légende reste vivace.
Eau
« Il y a de l’eau partout, mais pas de lac », évacue Jean-Luc Chavent, en tout pas de lac au sens où on peut l’entendre.
Emmanuel Bury
Confirme Emmanuel Bury, ancien président et actuel membre de l’Ocra, une association rassemblant des passionnés des souterrains lyonnais. Pas de lac mais des poches d’eau, situées sous l’Antiquaille.
Cavités
Les historiens lyonnais s’accordent en effet sur l’existence de cavités remplies d’eau, plus ou moins vastes.
Galeries et souterrains
La colline est, en effet, truffée de galeries et de souterrains. Ces tunnels, notre guide. les a parcourus à plusieurs reprises.
Descendu
Il est lui-même descendu, dans un souterrain rempli d’eau. sous la piste de ski de la Sarra.
Embarcation
« On a pu se déplacer avec une petite embarcation de plage à travers les galeries, mais c’est très étroit ».
Montée du Gourguillon
Sous la montée du Gourguillon, l’espace est même suffisamment large, l’eau d’une clarté si limpide, qu’on peinerait à croire qu’un tel endroit existe sans les clichés qui sont là pour en témoigner.
Lettre
Dans une lettre du 30 janvier 1931 destinée au maire, elle explique que l’on peut même y aller en bateau.
Souterrains
Point important à signaler : quel que soit l'état du temps extérieur (période sèche ou pluie diluvienne), le débit des eaux d'infiltration de certains souterrains ne varie pas.
Cavité conséquente
Y aurait-il une cavité suffisamment conséquente pour accumuler ces eaux et de par ce fait, d'en réguler leur évacuation ?
Cimetière de Loyasse
L'hypothèse n'est sûrement pas à écarter, car le phénomène de débit constant se passe bel et bien ! Ce lac, qui serait situé approximativement sous le cimetière de Loyasse, n'a officiellement jamais été retrouvé, bien que des témoignages en évoquent l'existence.
Exploration
Personnellement, je conclurais simplement en ajoutant que nous avons bien effectué une exploration dans une galerie sous Fourvière, où il nous a fallu utiliser un bateau pneumatique.
Un passage sous la saône ?
Effectivement, nous avons bien localisé une entrée qui pourrait potentiellement être cette fameuse galerie qui traverserait la Saône de part en part.
Instabilité
Nous sommes pourtant forcés de constater qu'actuellement l'instabilité extrême de ce souterrain empêche toute exploration.
Passage
Les premiers mètres passés un éboulement complique sérieusement la progression ; il semblerait cependant que le passage continue de façon dégagée derrière.
Galeries drainantes
Outre ces tunnels creusés à l’époque des Romains, la colline est également traversée par des galeries drainantes, dont la réalisation a été commandée à la suite de la catastrophe de Fourvière.
Objectif
Leur objectif : évacuer le surplus d’eau dans les poches d’eau souterraine de la colline. L’eau est ainsi déversée dans la Saône au lieu qu’elle ne s’infiltre en créant des dégâts.
Grande drainante
La plus connue de ces galeries, la Grande drainante, a été creusée de 1932 à 1937. Longue de 1,1 km, cette galerie en béton d’1m80 de hauteur et d’1m20 de largeur traverse la colline entre la montée Saint-Barthélémy et le quartier de Trion.
Neuf drains
Elle absorbe une importante quantité d’eau, qui s’évacue grâce à l’un des neuf drains qui la composent.
Grâce
« C’est peut-être grâce à la Grande drainante que la colline tient. »
Romains
Certaines de ces galeries réutilisent d’anciens égouts dont les Romains se servaient pour acheminer l’eau depuis les aqueducs.
20 mètres de profondeur
« Elles peuvent aller jusqu’à 20 mètres de profondeur ».
Accès condamnés
Aujourd’hui, bien malin celui qui arrive à pénétrer dans la colline. Les accès à ces souterrains sont désormais condamnés par de lourdes portes en métal, laissant tout juste entrevoir ce qui se cache derrière.
Aercevoir
On peut en apercevoir dans la montée Saint-Barthélémy et dans la montée du Chemin-Neuf. Certains adeptes de l'urbex parviennent toutefois à se faufiler dans les méandres de la colline, malgré l'interdiction.
Regret
Un regret partagé par plusieurs historiens et guides lyonnais : que la ville de Lyon n’autorise pas les visites, laissant par là même perdurer le mystère autour de ces tunnels qui plongent dans les entrailles de la terre.
Secrets
Comme si les secrets de la colline devaient rester enfouis à jamais.
Quand les Lyonnais profitaient des sources
Par le passé, entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, l’eau était extraite de la colline par les galeries et bue par la population.
Sources
« Ceux qui habitaient sur la colline faisaient creuser des tunnels de 15 ou 20 mètres de longueur, parfois plus, jusqu’a atteindre les sources, dépeint Emmanuel Bury. »
Canaliser
« Ils construisaient un mur de soutènement en sortie de souterrain pour avoir de la réserve et canaliser l’eau. »
Vaise et Saint-Paul
Le passionné des souterrains certifie que les vieilles maisons situées entre Vaise et Saint-Paul possèdent toutes des sources, puisées dans la colline, certaines seraient encore utilisées aujourd’hui.
Explorateurs
Les Romains étaient de redoutables explorateurs. Sur mais aussi sous la terre. Les nombreux souterrains remontant à l’époque de leur présence à Lyon sont là pour en témoigner.
Grotte Bérelle
Parmi les édifices qui leur sont attribués, la grotte Bérelle est un bijou peu connu. Cette citerne d’eau qui prend place sous l’esplanade du lycée Saint-Just, dans le 5e arrondissement, la grotte est sans doute le monument le mieux conservé de cette période dans le sous-sol de la ville.
Seize arcades en enfilade
Aujourd’hui fermée au public, la grotte a pourtant fait l’objet de plusieurs explorations au fil des siècles.
Plaque en fer
On y accède par une plaque en fer, puis un petit tunnel et quelques marches avant de déboucher à l’intérieur de la citerne.
Dimensions
Ses dimensions intérieures sont plutôt généreuses : 14 mètres par 15 et 3m60 de hauteur. Particularité du site : outre ses 16 arcades en enfilade.
Emmunuel Bury
« Elle n’est connectée à un aucune galerie ou aqueduc », affirme Emmunuel Bury, qui indique que « les voûtes sont recouvertes d’un enduit hydraulique qui sert de ciment naturel et rend la grotte totalement étanche »
Gironde : une épave vieille de 1300 ans découverte près de Bordeaux

Un bateau du haut moyen-âge découvert a côté de Bordeaux dans un état de conservation exceptionnel (©Loraine Dion).
De mai à septembre 2022, une dizaine d'archéologues vont s’employer à déterrer un navire daté du haut Moyen Age. L'un des rares vestiges de cette époque.
Vestige
C’est un vestige « extrêmement rare » que les archéologues de l’Inrap (institut national de recherches archéologiques) s’affairent à désensevelir depuis 2013, date de sa découverte à Villenave d’Ornon (Gironde).
Voilier marchand
Un voilier marchand de l’époque mérovingienne qui dort depuis 13 siècles dans le lit de l’estey de Lugan, les archéologues vont s’employer à le sortir de terre, planche par planche, pour une étude approfondie.
Port
L’existence d’un petit port, près de l’embouchure d’un cours d’eau latéral à la Garonne, dans une zone marécageuse exploitée dès l'Antiquité et durant toute l'époque médiévale, indique que ces secteurs, apparemment dénués d’intérêt, sont en réalité exploités pour leurs nombreuses ressources.
Intervention
Outre le dégagement et la préservation matérielle de l’épave, cette intervention archéologique nous permet déjà de comprendre son environnement et les raisons de sa présence en ces lieux.
Conservation exceptionnelle
Le navire, vraisemblablement assemblé au VIIe siècle, se trouve dans un état de conservation exceptionnelle grâce à une couverture de sédiments et de vase qui l’a préservé, au fil des siècles, des affres du soleil, de la chaleur et de l’oxygène.
Laurent Grimbert
Il est à ce jour le second bateau de ce type à avoir été découvert en France. En Europe, « il y en a moins de cinq », indique l’archéologue Laurent Grimbert, responsable des fouilles.
Vestige
Aussi pour préserver ce vestige d’un passé naval encore mal connu, les archéologues qui officient sur le chantier quotidiennement sont contraints d’arroser la structure boisée toutes les 30 minutes.
En miettes
« Sans cela, le bois éclaterait, et serait en miettes en quelques jours », souligne le responsable du chantier.
Découverte
L’histoire de cette découverte, qui aurait pu ne jamais être mise au jour, remonte à près d’une décennie.
Diagnostic
Comme l’y oblige la loi, préalablement à un projet immobilier, le promoteur qui souhaitait construire sur la parcelle a établi un diagnostic du terrain.
Lieux
Les services de l’Inrap, missionnés pour sonder les lieux, y avaient notamment trouvé un bâtiment du XVe siècle, et les restes d’un mur de clôture de l’époque médiévale.
Laurent Grimbert
« Les textes obligent à faire des recherches sur 10 à 12 % du terrain », indique Laurent Grimbert, qui a sciemment orienté les recherches vers le ruisseau.
Époque
« Il fait 50 cm de large aujourd’hui, mais on sait qu’il faisait plusieurs mètres de large à l’époque. Donc on s’en est rapproché. »
Hasard
« Cependant, l’endroit précis où nous avons fait cette tranchée reste le fruit du hasard ! »
Analyses
A ce moment-là, seule une infime partie de la carcasse est découverte. Les premières analyses des prélèvements permettent de dater le bois, attestant ainsi, auprès des services de l’Etat, qu’il s’agit là d’une découverte essentielle.
Fouilles
Mais ce n’est que six années plus tard, soit en 2019 le temps pour les demandes de financement de se frayer un chemin dans les méandres administratifs que les fouilles démarrent enfin.
Spécialistes
Selon les spécialistes, ce bateau long d’une quinzaine de mètres naviguait sur la Garonne et peut-être le long de la côte atlantique, entre les 7e et VIIIe siècles.
Voilier
Il s’agissait sans doute d’un voilier de charge destiné au transport de marchandises.
Marc Guyon
"Nous avons retrouvé des restes de plantes cultivées diverses, de blé, mais aussi de raisin, mais nous attendons d’avoir démonté les planches pour accéder au fond de la coque et éventuellement trouver d’autres indices plus parlants", a confié Marc Guyon, archéologue spécialiste d’architecture navale.
Naufrage
Les raisons du naufrage restent inconnues. Aucune trace de perforation n’a été trouvée par les archéologues pour le moment, le bateau pourrait avoir coulé tout simplement en raison de son usure…
 Sur le chantier de fouille de l’Inrap, à Villenave-d’Ornon, les archéologues arrosent les vestiges du bateau exhumé 1 300 ans après, pour éviter la détérioration des bois. © Crédit photo : Laurent Theillet/ « SUD OUEST ».
Sur le chantier de fouille de l’Inrap, à Villenave-d’Ornon, les archéologues arrosent les vestiges du bateau exhumé 1 300 ans après, pour éviter la détérioration des bois. © Crédit photo : Laurent Theillet/ « SUD OUEST ».
Dégagée
L’épave va être entièrement dégagée et documentée par relevés photos, restitution 3D, topographie et enregistrement des différentes pièces de bois. Elle sera démontée et numérotée pièce à pièce.
Analyser
Ce démontage permettra d’analyser dans le détail la construction du bateau, opération indispensable pour déterminer la tradition architecturale navale à laquelle il se rattache.
Découvert
« Nous avons alors découvert l’étendue du bateau. Tel qu’on le voit aujourd’hui, il fait 12 mètres, mais on suppose qu’il en faisait 15 », s’enthousiasme encore l’archéologue.
Écueil
Il se retrouve néanmoins face à un nouvel écueil : les parois du chantier, creusé dans le lit de l’ancien bras du fleuve, s’effondrent systématiquement.
Visibilité
Nous avions quelques minutes de visibilité avant que nos fouilles ne soient de nouveau ensevelies.
Système de pompage
Un système de pompage et de palplanches est installé, permettant de descendre aux abords du bateau à sec.
Chantier
Mais cela repousse le chantier au mois de mai 2022. Depuis cette date, les équipes de l’Inrap s’appliquent à numéroter chaque pièce de la structure.
Étudiées
Elles sont ensuite démontées, acheminées sur un brancard vers leur lieu d’analyse où elles sont lavées, étudiées par un dendrologue (spécialiste du bois), puis re immergées, à l’abri de l’air et de la lumière.
Conservé
Découvert étonnamment bien conservé, ce bateau représente non seulement un intérêt lié à son âge et sa rareté, mais aussi au fait qu’il se trouve à la frontière entre le monde méditerranéen qui a un type de construction de bateaux et le monde nordique qui en a un autre.
Chronologie
« Nous avons déjà appris à quelle chronologie il se rattache. »
Construction architecture
Reste à savoir à quel courant de construction et d’architecture navale, pointe Paul Guyon, archéologue spécialiste du milieu subaquatique fluvial, dépêché sur les lieux.
Charges
Pour l’heure, les archéologues peuvent affirmer, au vu de la robustesse des membrures du bateau, que l’embarcation pouvait contenir beaucoup de charges. Probablement à des fins commerciales.
Marchandises
Venait-il chercher des marchandises ici pour les amener ailleurs ? Était-ce juste son port d’attache ?
Sédiments et graines
« Seule l’analyse de ce que nous récupérerons en fond de bateau, notamment dans les sédiments et les graines, nous permettra de tracer des hypothèses de route commerciale qu’il empruntait », répond Paul Guyon.
Navigation fluviale
L’autre certitude, d’après l’observation de sa structure, c’est qu’il se destinait à la navigation fluviale et au cabotage. « Mais le fait qu’il ait une quille est un élément qui nous permet d’affirmer qu’il sortait en milieu maritime », affirme encore le spécialiste.
Certitudes
Au rang de certitudes, seules ces deux données trônent. « Une fois démonté, le bateau nous apportera sans doute davantage de réponses, se hasarde-t-il… À moins qu’il n’amène davantage de questions. » Et pour la suite ?
1 ère option
L’une, qui se chiffre à plusieurs millions, consisterait à remplacer l’eau présente dans le bois par de la résine, pour pouvoir exposer ce vestige dans un musée.
2 ème option
La seconde, peu onéreuse, consiste à le ré enfouir là où il a été trouvé.
Visite
Avant cela, une visite est prévue pour le grand public, à l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie, peut-être la seule et unique occasion d’apercevoir cette très vieille dame…
- Maitrise d’ouvrage et contrôle scientifique : Hélène Maveraud-Tardiveau et Loïc Daverat (DRAC Nouvelle-A)
- Responsable de la fouille : Laurent Grimbert (Inrap)
- Spécialistes d’architecture navale : Marc Guyon (Inrap) et Eric Rieth (CNRS)
Date de dernière mise à jour : 26/01/2024