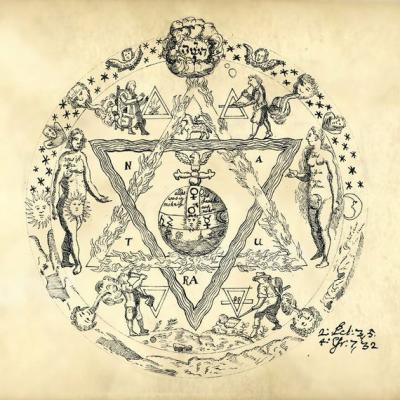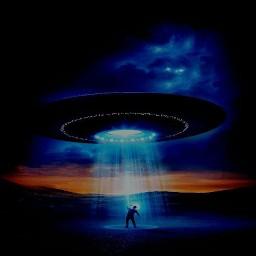Mystères 2

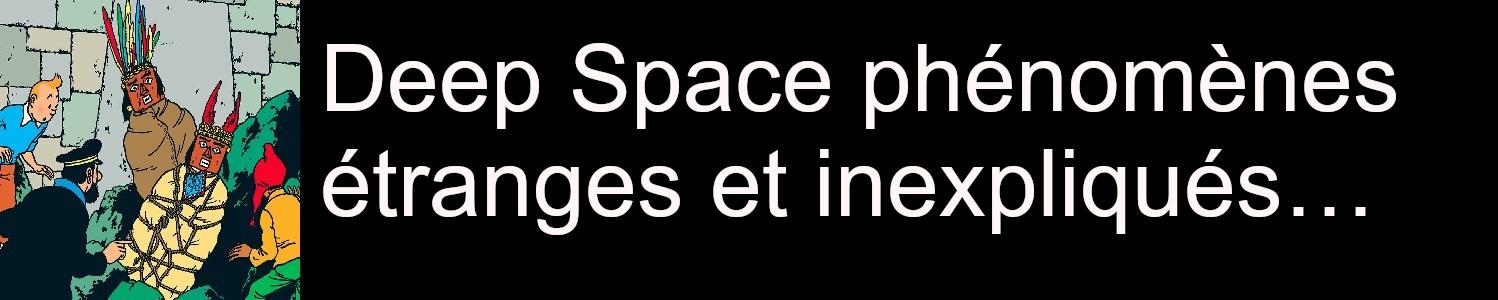
Le Vercors est un massif des Préalpes situé dans le Sud-Est de la France
 Le Mont Aiguille,Vercors.
Le Mont Aiguille,Vercors.
Le Vercors se dresse, comme une forteresse, son altitude varie de 180 mètres au bord de l'Isère à 2.341 mètres au sommet du Grand Veymont.
Pays
C'est un pays magnifique et unique où la diversité des paysages et des ambiances n'a d'égal que celle de sa flore et de sa faune.
Géologie
Géologie et géomorphologie du Vercors. Il y a environ 200 millions d'années (crétacé, époque des dinosaures), une mer immense couvre tout le domaine des Alpes actuelles.
Gestation
Le Vercors se trouve alors en gestation au fond de cette mer, subissant un climat doux permettant à la vie marine de proliférer (coraux, plancton...).
Calcaire
Le calcaire qui forme les coquilles et squelettes de ces organismes va s'accumuler, se tasser au fond de l'eau pendant des millions d'années, donnant naissance à de véritables bancs de roches (calcaires et marnes) de plusieurs centaines de mètres d'épaisseur.
Oganismes
Une partie de ces organismes marins a été conservée durant ces centaines de millions d'années au cœur de la roche, en formant les fossiles que l'on peut observer ici ou là, au cours d'une balade. Le Vercors est composé de roches sédimentaires qui ont été déposées et formées dans la mer au secondaire.
Mers
Les calcaires durs formés dans des mers peu profondes alternent avec les marnes et calcaires tendres formés dans des mers profondes, il en résulte un empilement de plusieurs kilomètres d'épaisseur un gigantesque millefeuille.
Massifs
Comme tous les autres massifs préalpins occidentaux alignés du nord au sud depuis le lac Léman, ces roches sédimentaires du Vercors se sont soulevées et ont été craquelées lors de la surrection des Alpes centrales.
Périodes
Lors des périodes froides qui se succédèrent de -2 millions d'années à -10.000 ans, l'érosion glaciaire a raboté les parties les plus élevées du massif.
Périglaciaire
L'érosion périglaciaire a généré les grands éboulis sous les falaises du Vercors.
Karstique
L'érosion karstique a dissous et sculpté les calcaires.
Torrentielle
L'érosion torrentielle a creusé les gorges (Bourne, Vernaison) et les reculées (Combe Laval, Bournillon).
Sédimentation
La succession de ces différentes phases de sédimentation, de soulèvements alpins, de plissements puis d'érosions, a conduit aux paysages d'aujourd'hui.
Alternance
Il est constitué principalement d'une alternance de versants verticaux, correspondant à l'érosion des calcaires durs, et de versants obliques, correspondant à l'érosion des marnes tendres, aujourd'hui, l'eau reste le principal agent d'érosion, mais elle a perdu beaucoup de son agressivité.
 Saint-Nazaire-en-Royans.
Saint-Nazaire-en-Royans.
Sortie
La sortie des eaux : il y a environ 100 millions d'années, le mouvement des continents va commencer à refermer cette mer. L'Afrique et l'Europe continuent de se rapprocher jusqu'à rentrer en collision, il y a environ 23 millions d'années.
Alpes
C'est la naissance des Alpes. Cette collision, qui est le fruit de forces colossales, va obliger les roches européennes et africaines à se mélanger, fusionner, se plisser et s'empiler sur plusieurs kilomètres de hauteur.
Processus
Durant ce processus, la plaque africaine va globalement passer sur la plaque européenne, raclant, plissant et fracturant au passage les roches sédimentaires formées précédemment.
Eaux
C'est ainsi que le Vercors sort définitivement des eaux, s'élève de plus de 1000 m et met en place les grands traits de sa structure.
Traces
On voit encore aujourd'hui de nombreuses traces de cet épisode au travers des plissements et fractures qui forment les paysages actuels.
Érosion
L'érosion en marche : dès leur formation, les Alpes vont être soumises à une érosion intense : les éléments naturels (eau, vent, gèle...).
Matériaux
Ils vont arracher les matériaux sur les hauts sommets et les fleuves vont les transporter jusqu'aux plaines en les déposant temporairement au grès des dynamiques fluviales.
Périodes
Il y a 2 millions d'années commence une succession de périodes glaciaires de grande ampleur, qui vont ralentir il y a environ 10 000 ans.
Façonner
C'est durant cette période, par le jeu successif de l'érosion glaciaire et de celle des rivières torrentielles, que le massif du Vercors va se façonner.
Modeler
Se modeler pour créer cette diversité de formes du relief (géomorphologie) et de matériaux (géologie), première ossature des milieux riches et variés du territoire.
 Les hauts plateaux du Vercors.
Les hauts plateaux du Vercors.
Climat
Situé à la transition entre les Alpes du Nord et du Sud, le Vercors est soumis à la triple influence climatique de l'altitude, des précipitations océaniques et des régimes méditerranéens.
Richesse
C'est le jeu subtil de ces influences mais aussi du relief qui explique en grande partie l'exceptionnelle richesse botanique et faunistique du Vercors.
Contraste
Le Vercors présente un contraste frappant entre les versants méridionaux à flore d'affinité méditerranéenne et les reliefs du nord recouverts d'une végétation de teinte septentrionale, cette opposition est particulièrement palpable de part et d'autre du col du Rousset.
Diois
Sur une même pente du Diois, on peut ainsi rencontrer l'edelweiss ou la chouette de Tengmalm, symboles de la montagne froide, et le thym ou le petit duc, méditerranéens.
Précipitations
Les précipitations sont aussi caractérisées par de grandes disparités : maximum de 1.649 millimètres pour 133 jours en moyenne par an en bordure ouest (Saint-Gervais) contre 880 millimètres pour 89 jours en bordure sud (diois).
Plateaux
L'enneigement sur les hauts plateaux dure de six à sept mois (de novembre à mai) et peut atteindre plusieurs mètres certaines années alors que d'autres sont au contraire très peu enneigées.
 Route vertigineuse de la Combe Laval / Vercors .
Route vertigineuse de la Combe Laval / Vercors .
Histoire
Grâce à son histoire géologique et à ses multiples influences écologiques, le Vercors dispose d'une grande variété de milieux.
Falaises
Vallées alluviales de la Drôme et de l'Isère, falaises pouvant atteindre 400 mètres, grottes par centaine, collines boisées, plateaux couverts de prés de fauche et de pâturages, hauts plateaux à pelouses subalpines et forêts de pins à crochets, crêtes alpines ventées aux pentes rocailleuses.
Le mystère du monstre marin découvert en Antarctique
 Cette illustration représente un élasmosaure évoluant à travers des eaux agitées. Un fossile découvert en Antarctique est à présent l'animal le plus massif jamais découvert de ce groupe de reptiles marins préhistoriques.
Cette illustration représente un élasmosaure évoluant à travers des eaux agitées. Un fossile découvert en Antarctique est à présent l'animal le plus massif jamais découvert de ce groupe de reptiles marins préhistoriques.
Cet élasmosaure de 15 tonnes est une nouvelle preuve de la grande richesse de l'écosystème aquatique peu de temps avant l'extinction massive des dinosaures.
Extraire
Il aura fallu des décennies de combat acharné contre les conditions météorologiques d’une île désertique au large de la Péninsule Antarctique pour que les paléontologues parviennent finalement à extraire l’élasmosaure le plus massif au monde.
Reptile
Cet ancien reptile marin, qui parcourait les mers du Crétacé aux côtés des dinosaures, aurait pesé environ 15 tonnes, il rejoint aujourd’hui la liste des fossiles de reptiles anciens les plus complets jamais découverts en Antarctique.
Plésiosaures
Les élasmosaures constituent un genre de la famille des plésiosaures qui compte parmi ses membres les plus grands certaines créatures aquatiques du Crétacé.
Généralement
Généralement, les plésiosaures ressemblent à de grands lamantins au long cou et à la tête de serpent, bien qu’ils disposent de quatre nageoires contrairement au lamantin qui n’en a que trois.
Scientifiques
L’équipe de scientifiques pense que ce tout nouveau poids lourd appartient au genre Aristonectes, un groupe dont l’espèce se démarque des autres élasmosaures.
Spécimens
Ils diffèrent en de nombreux points des spécimens fossilisés découverts aux États-Unis. Ce genre, que l’on retrouve en règle générale dans l’hémisphère sud, se caractérise par son cou plus court et son crâne plus large.
José O’Gorman
« Cette question est restée un véritable mystère pendant des années, nous ne savions pas si ces fossiles étaient des élasmosaures, » indique José O’Gorman, paléontologue au Conseil national de la recherche scientifique et technique (CONICET) en Argentine, basé au musée de la Plata non loin de Buenos Aires. »
Étrange
« Ils étaient une sorte d’étrange plésiosaure que personne ne connaissait. »
Spécimen
Les chercheurs avaient besoin d’un spécimen plus complet et, comme le hasard fait bien les choses.
Identifié
L’Université Purdue avait identifié un candidat potentiel à l’occasion d’une expédition menée en 1989 sur l’île Seymour, située au sud de l’extrémité nord de la péninsule Antarctique.
Fossile
Il ne disposait toutefois pas à l’époque du matériel et des ressources nécessaires pour mettre au jour le fossile, mais avait tout de même averti des chercheurs argentins de sa découverte.
Impliqué
L’Institut Antarctique Argentin s’est impliqué dans la mission et a commencé les fouilles dans le cadre de ses expéditions estivales annuelles, mais l’excavation du fossile avançait à un rythme très lent en raison de la météo et de la logistique.
William Zinsmeister
Il n’avait que cinq ans lorsque le fossile a été identifié par William Zinsmeister en 1989, en 2012, il était suffisamment âgé pour prendre part à la première expédition.
Travailler
Il n’était possible de travailler que quelques semaines au mois de janvier et au début du mois de février.
Météo
Certaines années, il était impossible d’avancer en raison des conditions météo et des ressources limitées.
Dégeler
Les jours ouvrés, l’équipe devait attendre que le soleil se lève pour dégeler la glace avant de pouvoir entamer les fouilles.
Morceau
Chaque morceau arraché à la terre devait ensuite être acheminé par hélicoptère à la base argentine de Marambio, à quelques kilomètres de là.
Anne Schulp
« Premièrement, ce type de mission exige un peu plus d’efforts et de moyens logistiques, puis ce n’est pas donné à tout le monde de tomber sur des fossiles du genre, » consent Anne Schulp, elle est paléontologue des vertébrés à l’Université d’Utrecht aux Pays-Bas et au Naturalis Biodiversity Center, non impliqué dans l’étude. »
 Dinosaures, le jour où tout a basculé (Image d'illustration).
Dinosaures, le jour où tout a basculé (Image d'illustration).
Excavation
C’est en 2017 que les fouilles ont abouti avec l’excavation d’une grande partie du squelette de l’animal décrit par O’Gorman et ses collègues dans leur rapport publié récemment par Cretaceous Research.
Éléments
« Nous n’avons pas le crâne, mais nous détenons de nombreux éléments du reptile, » précise O’Gorman. Selon leurs estimations, le fossile d’élasmosaure qui n’a pas encore trouvé de nom pesait entre 11,8 et 14,8 tonnes pour une longueur d’environ 12 m de la tête à la queue.
Aristonectes
Alors que certains Aristonectes découverts précédemment pesaient environ 11 tonnes, le poids de la plupart des autres élasmosaures ne dépassait pas les 5 tonnes, « Ce spécimen est énorme ! » commente Schulp face aux photos des os de l’animal.
Chercheurs
Il pense que l’équipe de chercheurs a accompli un travail de qualité et il est heureux de voir qu’elle n’a pas tiré de conclusions à la hâte.
Preuves
En effet, O’Gorman hésite même à affirmer si oui ou non l’espèce appartient définitivement au genre Aristonectes, étant donné qu’elle pourrait être attribuée à un tout autre genre si de futures preuves le permettaient.
 Ce crâne quasi-complet teinté de noir appartient au spécimen de Tyrannosaurus rex le plus complet actuellement exposé en Europe, surnommé Tristan Otto.
Ce crâne quasi-complet teinté de noir appartient au spécimen de Tyrannosaurus rex le plus complet actuellement exposé en Europe, surnommé Tristan Otto.
Travailler
Schulp a déjà eu l’occasion de travailler sur des plésiosaures des Pays-Bas et il reconnaît que les reptiles marins sont très différents dans l’hémisphère sud.
Aspect
Un autre aspect très intéressant de ce nouveau spécimen est la période à laquelle il a été daté qui s’approche de la fin du Crétacé, à peine 30 000 an
Extinction
Avant l’extinction de masse responsable de l’extinction des dinosaures non-aviens il y a environ 66 millions d’années, pour satisfaire les besoins nutritifs de ce monstre des mers, il aurait fallu que la vie aquatique de l’époque soit encore prospère.
Animaux
Le simple fait que ces animaux aient pu continuer d’exister à un stade aussi tardif du Crétacé suggère que le monde marin était, au bas mot, en bonne santé peu de temps avant l’extinction de masse, « même en Antarctique, il y avait encore de nombreux élasmosaures en bonne et due forme, » affirme Schulp.
Morphologie
La morphologie différente de cette espèce montre également qu’un processus de spécialisation était toujours à l’œuvre à un stade aussi avancé de l’existence des plésiosaures.
Montre
« Cela montre clairement que peu de temps avant la fin du Crétacé, les plésiosaures avaient réussi à diversifier leur régime alimentaire, » explique Schulp.
Habitudes
Alors qu’il est impossible de connaître avec précision les habitudes alimentaires de l’animal en l’absence des contenus fossilisés de son estomac ou d’autres preuves, O’Gorman imagine en se basant sur la taille de ses dents qu’il se nourrissait probablement de crustacés et de petits poissons.
Os
D’un autre côté, les travaux sur les os extraits au cours des dernières décennies viennent tout juste de commencer et à présent qu’ils sont entreposés dans un musée, O’Gorman déclare qu’il reste encore de nombreuses recherches à effectuer sur cet antique spécimen.
Connaissances
Schulp ajoute que ces recherches permettent d’enrichir nos connaissances sur les plésiosaures et il est enthousiaste à l’idée de voir d’autres paléontologues argentins s’aventurer sur ce terrain polaire et découvrir de nouveaux fossiles.
Attention
« L’hémisphère sud, ou du moins les plésiosaures, exigent une attention toute particulière, » poursuit-il.
Comblé
De son côté, O’Gorman semble comblé par l’expérience qu’il a vécue. « C’était assez froid, mais également très intéressant, une vraie aventure. »
Le record de descente dans le gouffre Berger
 L'entrée du gouffre Berger.Photo d'illustration Le DL/Jean-Benoît VIGNY.
L'entrée du gouffre Berger.Photo d'illustration Le DL/Jean-Benoît VIGNY.
Le réseau du gouffre Berger, alias réseau Berger Fromagère, situé sur le territoire de la commune française d'Engins en Isère, est un ensemble de cavités karstiques, renommé dans le milieu spéléologique.
Découverte
La première entrée a été découverte le 24 mai 1953 par Joseph Berger et ses compagnons, première cavité souterraine au monde à atteindre la profondeur mythique de -1000 mètres, le gouffre se situe sur le plateau de Sornin, à l’extrémité nord du massif du Vercors.
Question
Une question taraude alors quelques passionnés : d'où provient l'eau des Cuves de Sassenage ? Parmi eux, Jo Berger et ses camarades auscultent le gruyère du Vercors avec du matériel rudimentaire, parfois fabriqué au fond de leurs garages.
Plateau
C’est ainsi que le 24 mai 1953, sur le plateau du Sornin, Jo Berger, Bouvet, Ruiz de Arcaute et Marc Jouffray découvrent un nouveau "gouffre". Baptisé P 3, il deviendra bientôt le gouffre Berger.
Cavité
Si l'on ignore à l'époque l'importance de la cavité découverte, très vite une chose est établie. l'eau des Cuves de Sassenage provient bien de là.
Colorant
Un peu de colorant turquoise, parvenu jusqu'aux robinets des habitations de Sassenage, et la preuve est faite, mais côté spéléologie l'aventure ne fait que commencer, en mai 1953, on ne descend "qu'à" 103 mètres. Puis en juillet de la même année à -300 mètres. Puis en novembre à -375 mètres,
Progrès
Des progrès qui ne donnent qu'une envie : continuer l'exploration de ces mystérieuses entrailles. Mais en spéléologie comme en alpinisme, la météo commande, ce sera donc tout pour 1953. La saison finie, mieux vaut se concentrer sur 1954 et se préparer au mieux.

Matériel
Les spéléologues grenoblois renforcés par des camarades de Dijon, Lyon, de la Suisse, et même d'EDF, ont amené plus de 800 kilos de matériel et de vivres.
Camp de base
On a installé un camp de base à -300 mètres et posé accessoirement 250 mètres d'échelles et 310 mètres de cordes. Sans compter 350 autres mètres de cordes et 300 mètres d'échelles descendus pour la suite des événements.
Résultat
Cette quatrième expédition progresse jusqu'à -709 mètres. De quoi être émerveillé, mais avec une pointe de frustration. Car les spéléologues auraient bien voulu continuer.
Record
Surtout que le point le plus bas connu est alors détenu par la Pierre Saint-Martin à -730 mètres. Battre ce record paraît envisageable. Seulement, voilà, une cascade de 30 mètres a stoppé net l'expédition.
Franchir
En attendant d'arriver à la franchir, on a tout noté le long de "la rivière sans étoiles". Des salles, des lacs, des puits, chaque lieu exploré a été baptisé, souvent en donnant le nom de l'un des participants. Il y a donc le puits Garby, le puits Gontard, le lac Cadoux...
Canot
On s'est d'ailleurs réjoui d'avoir traversé ce dernier, long de 40 mètres et profond de 5 mètres, grâce à un canot pneumatique.
Plonger
Jusqu'à ce qu'il faille plonger dans ses eaux à 4 °C pour récupérer du matériel tombé à l'eau. Ce dédale dûment cartographié, on a bien évidemment décidé qu'une cinquième expédition s'imposait, le 10 septembre 1953, nouvelle tentative donc. À 15 h, un groupe de spéléologues s'enfonce dans les entrailles de la terre.
Sortir
On ne verra ressortir le premier d'entre eux que le 13 septembre 1953 à trois heures du matin. De retour à 1460 mètres d'altitude sur ce plateau de Sornin, l'exploit devient réalité : on a atteint les -753 mètres.
Record
Record du monde battu ! De 3 h à 5 h 30, les 21 membres de l'expédition vont ressortir du gouffre un à un.
Sain
Tout le monde sain et sauf, on peut enfin se réjouir et raconter. On peut montrer des insectes cavernicoles remontés à la surface, on peut rire des pastilles antiscorbutiques utilisées finalement pour nettoyer les lanternes, etc.
Échelle
Et la cascade ? Elle a été franchie grâce à une tige tendue horizontalement et une échelle métallique accrochée à son bout, en l'empruntant Jean Cadoux et Georges Garby ont été à peine éclaboussés. Après ? C'est une vaste galerie en pente douce...
 Une descente vertigineuse dans le gouffre Berger.
Une descente vertigineuse dans le gouffre Berger.
Réseau
C'est un réseau tentaculaire qui prend forme au fil des récits. Un réseau "que l'on pourrait contempler pendant des heures sans se lasser" affirme les spéléologues.
Perspective
Et c'est cela en ce mois de septembre 1954 qui fait rêver. Non pas le record du monde, mais la perspective que cette cinquième expédition en appelle d'autres et que le futur amènera sans doute d'autres découvertes, d'autres exploits.
Télégrammes
Le 11 août 1956, on battra ainsi un nouveau record du monde : -1100 mètres. À -1000 mètres, on a marqué le coup en envoyant des télégrammes.
Président
Le premier au président Coty, qui séjourne alors à Vizille: "Equipes Club Alpin Français et Internationales vous prient de recevoir depuis la cote -1000 leurs plus respectueuses salutations".
Félicitations
Réponse présidentielle : "En vous remerciant cordialement des sentiments profonds que vous avez bien voulu lui exprimer, votre voisin de Vizille adresse ses vives félicitations à tous ceux qui ont méthodiquement préparé et vaillamment réalisé cette belle victoire de la spéléologie, signé René Coty".
Sassenage
Pendant ce temps, les habitants de Sassenage accoururent eux le long du Furon, le torrent étant devenu d'un coup vert, la preuve d'un nouveau cours d'eau repéré à la cote -1000.

Équipe
Le 6 juillet 1996 (samedi). Une équipe mixte d’Anglais et de Hongrois descend au gouffre Berger. Ils sont formés de deux équipes de trois, à la descente, ils croisent des Britanniques qui ont dû attendre 12 heures de décrue pour remonter.
Bivouaquent
Les deux équipes bivouaquent à -500 mètres le samedi soir et descendent le dimanche. La première équipe de Hongrois (Istvan Torda 23 ans, Nemeth Zsolt 27 ans et Miklos Nierges 28 ans) vont au siphon terminal.
Puits
La deuxième équipe (Nicole Dollimore 30 ans, William Stead 36 ans et Karoly Tompa 24 ans) s’arrête au puits de l’Ouragan.
Descente
Nicole Dollimore reste pendant la descente de ses deux compagnons. Arrivé dans le grand Canyon, l’eau a monté.
Subit
Nicole subit dans le petit ressaut une brusque montée de l’eau, elle n’arrive pas à se dégager et reste pendue sur sa longe dans la cascade.
Tentatives
Malgré les nombreuses tentatives du Hongrois pour la secourir. Le groupe reste bloqué trois jours au-dessous de Nicole.
Coincé
L’autre au sommet de la cascade. La première équipe a été surprise par la crue. Les deux premiers arrivent à la remonter, mais le troisième Istvan meurt coincé dans la crue.
Embruns
Ils restent dans les embruns 48 heures, le niveau ayant baissé, ils décident de redescendre. Ils lancent une nouvelle corde, contournent leur camarade, puis descendent où les sauveteurs les retrouveront, le mercredi soir, ils sont remontés le vendredi et le dimanche. Le sauvetage s’est terminé, une semaine après le début de l’alerte.
Crue
La crue qui s’est abattue sur le Vercors nord-est la plus forte de l’année 1996. À la Goule Noire, le débit a dépassé 30 m3/s. Aux Cuves de Sasssenage, la grille d’entrée a été emportée par les eaux !
Secour
2019 opération de secour, le spéléologue âgé de 21 ans était parti pour le gouffre mardi 23 juillet 1996, vers 10 heures du matin, avec deux autres personnes, selon la préfecture, "il aurait ensuite divergé du groupe à 500 mètres de profondeur, reprenant le chemin de la sortie".
Trio
En effet, le trio s'est séparé, sans que l'on sache pourquoi. Il avait été vu pour la dernière fois vers 16 h 30 mardi, à environ 650 mètres de profondeur, par un autre groupe de spéléologues.
Signe
L'homme, qui n'avait plus donné signe de vie depuis mardi après-midi, souffrait d'une entorse à une cheville.
Héliporté
Il avait été héliporté par la sécurité civile. Le gouffre présente 37 kilomètres de galerie, une voie principale puis plusieurs chemins transversaux accessibles.
Gouffre
Son exploration est possible chaque année du 1er juin au 31 octobre, elle nécessite une inscription en mairie entre le 1er novembre et 31 décembre de l’année précédant l’expédition.
Histoire
L'histoire a été ponctuée d'accidents, de fâcheries avec la municipalité, mais le gouffre fascine toujours autant les spéléologues. Au fil des expéditions, jusqu'à -1271 mètres, ils lui ont découvert une dizaine d'entrées.
Une raie de 300 kg pêchée au Cambodge : il s’agit du plus gros poisson d’eau douce
 Cette raie de 4 mètres et 300 kg est le plus gros poisson d'eau douce jamais enregistré dans le monde.
Cette raie de 4 mètres et 300 kg est le plus gros poisson d'eau douce jamais enregistré dans le monde.
Une énorme raie géante de 300 kg a été pêchée dans le Mékong, au Cambodge, en 2022, avant d’être relâchée. Des scientifiques ont confirmé qu’il s’agissait du plus gros poisson d’eau douce enregistré dans le monde.
Pêcheur
Un pêcheur cambodgien a capturé dans le Mékong le plus gros poisson d’eau douce jamais enregistré d’après des scientifiques, une raie géante de 300 kg.
Boramy
Baptisée Boramy « pleine lune » en langue khmère en raison de sa forme, la femelle de quatre mètres de long a été relâchée après avoir reçu un implant électronique pour permettre de surveiller ses mouvements et son comportement.
Capturée
Capturée dans la province de Stung Treng au nord du Cambodge, elle pesait plus de deux fois le poids d’un gorille moyen, ont précisé les scientifiques.
Poisson
« En 20 ans de recherche, il s’agit du plus grand poisson d’eau douce que nous ayons rencontré ou qui ait été documenté dans le monde entier. »
Zeb Hogan
Dans un communiqué Zeb Hogan, directeur de Wonders of the Mekong, un projet de conservation financé par les États-Unis.
Découverte
« Il s’agit d’une découverte absolument étonnante qui justifie les efforts déployés pour mieux comprendre les mystères entourant la raie géante d’eau douce », a-t-il ajouté. Menacée par la surpêche, la pollution et la perte de son habitat, l’espèce est protégée.
 La raie géante a été baptisée Boramy.
La raie géante a été baptisée Boramy.
Boramy
Boramy a battu le record d’un poisson-chat géant de 293 kg qui avait été capturé en 2005 un peu plus en amont dans le nord de la Thaïlande.
Mékong
Le Mékong, l’un des fleuves les plus longs d’Asie (4 350 kilomètres de long), abrite la biodiversité aquatique la plus importante du monde après l’Amazone, avec plus de 1 000 espèces de poissons.
Spécimens
Des spécimens gigantesques comme le poisson-chat géant ou le barbeau géant qui peuvent atteindre trois mètres et peser jusqu’à 300 kg peuplent aussi ses eaux.
Profondeur
Le fleuve, qui atteint par endroits 80 mètres de profondeur, pourrait abriter des variétés encore plus grandes, d’après les scientifiques.
Fleuves
Le Mékong, l'un des fleuves les plus longs d'Asie (4.350 kilomètres de long), abrite la biodiversité aquatique la plus importante du monde après l'Amazone, avec plus de 1.000 espèce de poissons.
Spécimens
Des spécimens gigantesques comme le barbeau géant qui peuvent atteindre trois mètres et peser jusqu'à 300 kilos peuplent aussi ses eaux.
Vital
Vital pour la survie de millions de personnes en Asie du Sud-est, le Mékong et sa faune sont menacés par les dizaines de barrages construits par Pékin en Chine, au Laos et au Cambodge.
Pollution
La pollution est une autre source d’inquiétude. Des déchets plastiques ont été repérés même dans les zones les plus profondes du fleuve ainsi que des « filets fantôme » perdu ou abandonné par les pêcheurs dans lesquels les poissons peuvent se retrouver pris au piège.
Un mystérieux trou géant : vient d’apparaître dans le sol du Chili
 Un mystérieux trou géant vient d’apparaître dans le sol du Chili.
Un mystérieux trou géant vient d’apparaître dans le sol du Chili.
Un immense trou béant est apparu dans le sol, au Chili. Le gouffre s’étire sur quelque 32 mètres de diamètre, et est profond d’environ 200 mètres.
Autorités
Les autorités cherchent à savoir pourquoi et comment celui-ci est apparu. Un immense trou béant, qui forme un vaste rond au milieu d’une terre aride, seulement parsemé de quelques buissons.
Gouffre
Ce mystérieux gouffre s’est ouvert dans le sol, près de la ville de Tierra Amarilla, au Chili. Les autorités ont pris connaissance de son apparition samedi 30 juillet 2022, rapporte l’agence de presse Reuters mardi 2 août 2022.
Existence
L’existence du gouffre a été confirmée par le Service national de géologie et des mines du Chili (Sernageomin).
David Montenegro
Selon le directeur de l’institution, David Montenegro, le trou court s’enfonce dans le sol sur environ 200 mètres !
Diamètre
Son diamètre : quelque 32 mètres, annonce l’agence publique dans un communiqué. Le trou est apparu sur des terres exploitées par la société minière canadienne Lundin Mining, où se déroulent des opérations minières d’extraction de cuivre.
Communiqué
L’entreprise a indiqué, dans un communiqué, qu’un périmètre de sécurité avait été mis en place autour du trou et qu’aucun blessé ni dégât matériel n’étaient à déplorer. Ce qu’ont également confirmé les autorités chiliennes.
Assuré
Lundin Mining a aussi assuré que l’habitation la plus proche était située à 600 mètres de là et que le trou était « stable ».
Spécialistes
Le Sernageomin a envoyé des spécialistes sur place afin de procéder à des investigations, et ils travaillent avec la société afin de déterminer l’origine de ce mystérieux gouffre.
Experts
Plusieurs experts du Service national de la géologie et des mines (Sernageomin) ont rapidement été envoyés sur place pour tenter de comprendre comment une telle crevasse, appelée doline, avait pu se former.
Doline
Une doline est en général observée quand des cavités souterraines contenant de l’eau s’effondrent sous le poids du sol.
 Situation de la petite ville de Tierra Amarilla au Chili.
Situation de la petite ville de Tierra Amarilla au Chili.
Cas
Dans le cas présent, difficile de parler d’un phénomène naturel. D’après le maire de la petite ville de Tierra Amarilla, située aux abords du trou, ce dernier serait une conséquence directe des activités extractives excessives menées dans la région. « C’est le plus grand gouffre que nous ayons vu. »
Inquiets
Nous sommes très inquiets, car il continue de s’étendre. Notre communauté n’avait jamais vu ça, dénonce l’édile dans les médias locaux.
Zone
Pour sa part, la société reconnaît l’existence du gouffre et ne nie pas en être à l’origine. Dans un communiqué, elle assure que la zone a été immédiatement vidée et les autorités chiliennes prévenues et qu’aucune personne ou infrastructure n’a été touchée.
Extractions
Les extractions ont même été suspendues par mesure de sécurité. Mais contrairement aux déclarations du maire, Lundin Mining jure que le trou est stable et ne s’étend pas.
Tierra Amarilla
Le maire de Tierra Amarilla, 13 000 habitants, a demandé des explications. Il s’est demandé si le trou s’était formé en raison d’activités minières ou non, ce que devront donc déterminer les investigations menées sur place.
Constatée
Ce n’est pas la première fois que de tels phénomènes se produisent. L’apparition de ces trous est régulièrement constatée, un peu partout dans le monde.
Chine
Ainsi, en Chine, un gouffre géant identifié par des scientifiques au mois de mai 2022 laissait apparaître une forêt primitive.
De retour dans les forêts françaises : le Lynx vit toujours entouré de crainte et de mystère
 Un lynx. - © Patrice Raydelet.
Un lynx. - © Patrice Raydelet.
Patrice Raydelet, auteur et photographe fasciné par ce grand félin, le piste dans le Jura et fait tout pour le protéger.
Obscurité
Il fait défiler les fichiers vidéos. Dehors, dans l’obscurité grandissante, les cimes des majestueux conifères dansent au gré des bourrasques.
Silhouette
« Bingo ! » S’écrit-il brusquement. Sur l’écran sombre, apparaît la silhouette élancée d’une bestiole à la fourrure tachetée.
Poils
Une touffe de poils noirs orne le sommet de ses oreilles triangulaires. Les yeux bleus du naturaliste s’illuminent.
Rocky
« Je te présente Rocky, le mâle du coin. » Patrice est tombé dans la fascination du lynx boréal. Auteur et photographe animalier, il y a consacré sa vie :
Passion
« Ce n’est pas un métier, ni même une passion. C’est un chemin de vie, une obligation, un combat, dit-il d’un accent jurassien à couper au couteau. »
Contreforts
Dans les contreforts de son Jura natal, il nous a emmené à la découverte de ce mammifère fantomatique et menacé, classé « en danger de disparition » sur la liste rouge française de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).
Histoire
« C’est par là » a pas-de-géant, Patrice grimpe en direction d’une crête arborée. Le souffle à peine saccadé, il nous plonge dans l’histoire de ce mystérieux félin. Au Moyen Âge, son aire de répartition s’étendait de la péninsule ibérique aux confins de la Sibérie.
Victime
Victime de la chasse, de la destruction de son habitat et de la raréfaction de ses proies, il disparut de l’Europe de l’Ouest à la fin du XIX siècle.
Trace
« L’ultime trace que j’ai trouvée dans les archives départementales du Jura remonte à 1885, détaille le fondateur du pôle Grands prédateur. »
Homme
Un homme racontait avoir tué et enterré un énorme chat sauvage, à la queue courte et aux oreilles pointues.
Lynx
« J’ai compris qu’il s’agissait d’un lynx et qu’à cette époque, personne ne connaissait cette espèce. » Un grand trou noir d’un siècle. Le lointain cousin du puma ne réapparut dans le massif jurassien qu’en octobre 1974.
Réintroduits
« Trois ans, plus tôt, quelques lynx avaient été réintroduits en Suisse. Une femelle a parcouru 100 km à vol d’oiseau pour finalement être sauvagement abattue, à Gex, dans l’Ain. » Patrice interrompt sa marche, mains sur les hanches. Sous sa manche, se dévoile un tatouage.
Empreintes
Des empreintes de lynx. « Voilà. Sa disparition et son retour ont été marqués par deux bêtes flinguées par l’Homme. » Sous nos pieds, le bruissement de l’humus, dont l’odeur emplie l’air frais, s’accorde avec le chant d’un geai des chênes.
Voir
Patrice s’accroupit et examine les selles semées par un lynx. Alors, l’esprit s’emballe : peut-être allons-nous le voir ? Il sourit.
Attendu
« J’ai attendu vingt ans pour avoir la chance de croiser son chemin dans le Jura. Et dire que ça s’est joué à une bière… »
Années
À la fin des années 2000, le photographe rendit visite à un éleveur pour travailler à la mise en place de chiens de protection.
Moment
« Au moment où j’allais partir, il m’invite à prendrer un verre. Je cède et finis par m’en aller assez tardivement », la nuit était tombée sur la vallée.
Phares
Dans les phares de sa voiture, il aperçut au loin filer deux ombres furtives : « Putain, des lynx ! » Il écrasa aussitôt sa pédale de frein, s’arrêta en travers de la route et sauta sur le bitume.
Appeler
« Je me suis mis à les appeler, poursuit-il en gesticulant pour imiter la scène. Et paf ! »
Jeune
« Un jeune lynx fit demi-tour, intrigué et s’assit à deux mètres de moi. » Ils passeront quelques minutes tous les deux allongés dans le fossé.
Moment
« C’était un moment fabuleux, une proximité inoubliable. Je ne suis jamais rentré aussi léger » .
Histoire
Cette histoire est si surprenante qu’on la croirait sortie d’un conte fantastique. Le lynx, n’est-il pas un animal farouche ? « Loin de là ! Il est simplement extrêmement discret » .
Vu
« C’est lui seul qui décide s’il veut être vu ou non. En Andalousie, je me suis baladé avec un mâle… Il marchait à côté de moi, comme si je promenais mon chien. » Le passionné palpe parfois dans leur regard une pointe de curiosité. Plus souvent, rien que l’indifférence.
Rencontres
De telles rencontres, il peut les compter sur les doigts de ses mains.
Sommet
Arrivé au sommet d’une petite paroi rocheuse, l’homme aux cheveux grisonnants retire son sac à dos et s’en va récupérer les cartes mémoire de ses pièges photographiques, dissimulés dans la broussaille, installés au cœur du printemps, ils lui permettent d’assurer un suivi des lynx vivant dans les parages.
Piste
Sans trop y croire, le Jurassien est parti sur la piste du lynx, dès qu’émergea la rumeur de son retour, à l’aube des années 1990.
Légendes
Il comprit alors qu’hormis les fantasmes et les légendes, les connaissances scientifiques sur l’espèce étaient quasi inexistantes. « Et pour ses défenseurs, ce n’était qu’un bon gros chat sympa. »
Parc
De 1991 à 1997, c’est dans un parc zoologique de Bavière qu’il apprit à les observer, les écouter, imiter leurs cris. « Ça peut sembler étrange, s’amuse-t-il, mais à l’époque, il n’y avait rien pour étudier leur comportement. »
Population
Aujourd’hui, la population française de lynx avoisine les 150 individus, dont plus des deux tiers habitent les sapinières jurassiennes.
Femelles
« Dans le massif, on observe de plus en plus de femelles suitées, ce qui était très rare autrefois », se réjouit le spécialiste.
Où
Où sont-ils ? Au printemps 2021, quarante-deux portées de un à quatre chatons avaient été recensées sur les départements de l’Ain, du Doubs et du Jura. Où sont-ils ? Comment se fait-il que la population ne semble pas s’étoffer ? Je ne comprends pas… »
Trafic
Officiellement, le trafic routier est la première cause de mortalité chez ces animaux. Chaque année, une quinzaine d’entre eux meurent percutés par un véhicule. « Ça paraît peu, mais c’est tout de même 10 % de la population nationale » .
Conducteurs
Alors Patrice tente d’inciter les conducteurs à lever le pied et réfléchit à l’élaboration de passages à faune, au-dessus ou en dessous des routes les plus accidentogènes, avec le Parc naturel régional du Haut-Jura.
Zones
La fragmentation du couvert forestier par les zones urbanisées complique également, voire empêche, la dispersion des individus et les échanges entre noyaux de population différents.
Isolements
À l’avenir, ces isolements risquent d’engendrer un affaiblissement génétique de l’espèce.
Braconnage
« Et puis, il y a le braconnage. Une cause de mortalité qu’on peine à chiffrer, mais qui est bien réelle, déplore Patrice, la main posée sur l’écorce d’un hêtre. »
Écœuré
« Je suis écœuré quand j’entends les chasseurs, inquiets de manquer de gibiers, vouloir la peau du lynx.
Régulation
« Et après, ces prétendus amoureux de la nature veulent nous faire gober qu’ils ne chassent que pour la régulation ? »
Plan
Lancé en 2022 par le ministère de la Transition écologique, un plan national d’actions entend rétablir le félin aux mouchetures noirâtres « dans un état de conservation favorable ».
Initiative
S’il salue l’initiative, Patrice déplore l’absence de moyens octroyés aux investigations, dans la lutte contre les destructions illégale.
Monstres
« Il y a une vingtaine d’années, quand je demandais à une classe élémentaire de me dessiner un lynx, plus d’un tiers des élèves me rendaient des monstres aux dents dégoulinantes de sang. »
Connaissances
« Maintenant, les gamins ne font plus ça. » aux yeux de Patrice, l’acceptation des prédateurs et leur cohabitation avec les humains passeront par davantage de cultures et de connaissances.
Journalistes
« Les journalistes illustrant leurs papiers par un loup ou un ours à l’allure féroce modélisent dans l’esprit des citoyens une image négative de ces animaux. Ce n’est plus possible » .
 Patrice Raydelet a été garde de réserve naturelle et a travaillé dans un centre de soins. © Emmanuel Clévenot.
Patrice Raydelet a été garde de réserve naturelle et a travaillé dans un centre de soins. © Emmanuel Clévenot.
Livres
Au XIX siècle, et encore aujourd’hui dans certains livres, le lynx était appelé « loup-cervier ». Ce terme émane de superstitions qui courraient sur l’espèce depuis le Moyen Âge :
Cervelle
« À l’époque, on racontait qu’il se cachait dans les arbres en attendant que passe sa proie, pour lui sauter sur le dos et lui arracher la cervelle. » Un comportement fantasmé qui, additionné à son feulement associé au hurlement du loup, le dota de cet étrange surnom.
Légendes
« En diffusant ces légendes, les savants et les curés ont causé beaucoup de torts au lynx. » Étudier ce mammifère, c’est finalement accepter une perpétuelle remise en cause des connaissances amassées.
Naturaliste
« Il y a peu, un naturaliste biélorusse a observé un mâle tuer un chevreuil et en offrir la carcasse à une femelle et ses petits, poursuit Patrice, les sourcils levés. »
Imaginé
« Jamais on aurait imaginé ça ! Tout le monde pensait qu’il abandonnait la femelle aussitôt après s’être accouplé. »
Ciel
Le ciel s’est obscurci. Patrice se faufile sous un vieux fil barbelé, servant de clôture à quelques vaches au pelage blanc-crème.
Suspens
À l’autre bout du champ, apparaît la maison. « Le suspens est à son comble », sourit-il, en sortant de sa poche les cartes mémoire. Auront-elles immortalisé un instant de la vie secrète du fantôme des forêts ?
Le hum : bruit mystérieux qui fait fantasmer internet
 Étranges et puissants sons « hum » entendus à travers le monde.
Étranges et puissants sons « hum » entendus à travers le monde.
Depuis plusieurs décennies, en divers endroits du monde, 2 % à 10 % des individus entendent un bourdonnement incessant.
Bruit
Le "hum" (bourdonnement, vrombissement). Ceux qui l'entendent le décrivent comme un bruit sourd, un bourdonnement semblable au moteur d'un camion tournant au ralenti, d'un orage lointain ou d'un avion volant à basse altitude.
Imprévisible
Il peut se déclencher de manière imprévisible, s'arrêter tout aussi soudainement. Sa durée tout comme son intensité est variable. États-Unis, Angleterre, continent européen, Australie : ce mystérieux son est entendu en divers endroits de la planète.
Témoignages
Les premiers témoignages remontent aux années 1970-80 et ils se sont multipliés ces dernières décennies.
Authentifier
Si ces témoignages-là sont difficiles à authentifier, il existe des exemples emblématiques ayant fait l'objet de reportages et d'études scientifiques.
Taos
C'est notamment le cas à Taos au Nouveau-Mexique, à Kokomo dans l'Indiana (États-Unis), à Bristol (Angleterre), ou encore à Windsor (Canada). À chaque fois, le scénario est le même : une partie de la population se plaint d'entendre un bruit persistant.
Vibration
Les personnes qui y sont sensibles affirment que ce son est apparu de manière soudaine et vibre dans les oreilles en permanence.
Bouchons
Utiliser des bouchons d'oreille ou un casque anti-bruit n'y change rien. Elles continuent à l'entendre en continu, qu'elles soient à l'intérieur ou à l'extérieur et ne parviennent pas à identifier la source de ce vrombissement.
Population
Étrange. D'autant que seule une faible fraction de la population est concernée. Alors acouphènes ? Réalité ? Ou hallucination collective ?
Études
Les premières études menées à Taos et Kokomo , respectivement en 1993 et 2003, afin de le vérifier. Première certitude le "hum" n'a rien à voir avec des acouphènes.
Ressentis
Ces derniers sont des bruits internes (ressentis dans les oreilles ou dans la tête) qui ne sont pas émis par une source extérieure.
Permanence
De plus, les personnes qui en souffrent les entendent en permanence, où qu'elles se trouvent. Or, le "hum" semble en général lié à une aire géographique (une ville, un État).
Personnes
"La plupart des personnes qui le perçoivent ne l'entendent plus lorsqu'elles quittent la zone", selon James P. Cowan, ingénieur en contrôle du bruit qui fut en charge de l'étude menée à Kokomo. La source du "hum" est donc extérieure, localisée.
Zone
La zone peut être très vaste, comme le prouve l'exemple du "hum de Windsor". Dans ce cas, le bourdonnement ne se limite pas seulement à la ville, mais serait aussi entendu à McGregor, distante d'une trentaine de kilomètres, et Cleveland, à plus de 144 kilomètres...
Population
Et même si la fraction de la population capable de l'entendre est assez faible, (entre 2 % et 10 %), "ces personnes ne sont pas folles", affirme James P. Cowan. "Ce qu'elles entendent est réel".
Pénible
Le "hum" est pour elles extrêmement pénible. Mais dans un certain nombre de cas, il peut même s'accompagner de maux de tête, de nausées, diarrhées, de fatigue et de pertes de mémoire. Reste à savoir d'où il vient. Et c'est bien là le problème.
Mesures
À Taos, la batterie de mesures réalisées ont mis en évidence un champ électromagnétique élevé, provoqué par les lignes électriques locales.
Dysfonctionnements
Ainsi que des dysfonctionnements d'appareils électriques dans et autour des maisons des "victimes" du "hum", mais aucun signal acoustique n'a été détecté. Conclusion : le "Taos hum" n'a pas pu être localisé.
Scientifiques
Outre un champ magnétique élevé, les scientifiques ont détecté des sons de basses fréquences provenant de deux installations industrielles.
Intensité
Une fois l'intensité de celles-ci réduite, certains des habitants qui se plaignaient d'entendre le "hum" ne l'ont plus ressenti.
Bilan
Mais la plupart des personnes affectées ont continué à l'être. Bilan : le "Kokomo hum" n'a pas non plus été clairement identifié.
Ondes
À Bristol, les médias britanniques ont attribué le "hum" aux ondes émises par l'action des vagues sur le fond marin.
Fabrice Ardhuin
Or, "cela n'a rien à voir", soupire Fabrice Ardhuin, l'un des auteurs de l'étude sur le sujet. "Ce que nous appelons le bourdonnement de la Terre, ce sont des vibrations qui correspondent au mouvement de la croûte terrestre, qui monte et descend à des fréquences qui se comptent en milli hertz", explique-t-il.
Vibre
"On est loin de quelque chose qui vibre plusieurs fois par seconde".
Bruit
"Donc lorsqu’on parle de bruit de la Terre, ce n’est pas au sens audible du terme." Mais lors de la publication de l'étude, les chercheurs ont employé le mot "bourdonnement", autrement dit "hum". Beaucoup ont donc sauté sur l'explication "et n'ont rien compris", conclut le chercheur de l'Ifremer.
Retour
Retour à la case départ donc, et aux coupables habituellement pointés par les experts sur place : les bruits de basses fréquence émise par des activités industrielles et/ou les lignes électriques.
Experts
Quant à Windsor, où le "hum" sévit depuis 2011, les experts estiment que les coupables pourraient être les hauts fourneaux du producteur d'acier américain US Steel situés sur l'île Zug, du côté américain de la rivière Détroit.
Compagnie
Mais selon le New York Times , la compagnie fait la sourde oreille et les autorités américaines refusent de coopérer, empêchant les experts de pointer la source exacte du "hum".
Colin Novak
Comme l'a résumé l'un des scientifiques, le professeur Colin Novak, essayer d'identifier le "Windsor hum" revient à "chasser un fantôme".
Pistes
Autant d'exemples qui montrent que si les experts ont des pistes sérieuses concernant le "hum", ils n'ont pas vraiment de certitudes, si ce n'est que son origine est humaine et que ses sources sont multiples
Explication
"L'explication la plus probable est que certaines personnes ont la capacité d'interpréter des transmissions radio à certaines longueurs d'onde (notamment à basse fréquence)".
David Deming
Voilà pourquoi tout le monde n'est pas sensible au "hum". Selon David Deming, seules 2 % à 10 % des personnes sont capables de l'entendre, ou plutôt le ressentir, puisqu'il ne s'agit pas d'un son à proprement parler.
Ondes
Et le fait qu'il s'agisse d'ondes radio expliquerait aussi pourquoi le "hum" peut se manifester à divers endroits de la planète, comme le montre la carte ci-dessous, qui ambitionne de recenser les occurrences du "hum". Cela expliquerait aussi pourquoi le phénomène est relativement récent.
Audible
Et dans la mesure où le "hum" n'est "audible" que pour une petite fraction de la population, à qui il pourrit la vie pour dire les choses simplement.
Confusion
Il ne faut pas non plus le confondre avec les autres "bruits" non expliqués qui peuvent survenir de manière ponctuelle.
Arctique
Comme le mystérieux "bip" entendu par les Inuits dans l'Arctique fin 2016 et pour lequel l'armée canadienne, dépêchée pour enquêter, n'a pas trouvé d’explication. Cela n'avait en tout cas rien à voir avec le "hum".
Canulars
Gare également aux nombreux canulars qui peuplent le web (et il y en a...).
Voyage au centre de la Terre
 La mine de Naïca.
La mine de Naïca.
Comme le roman de Jules Verne, vous allez pouvoir pénétrer dans les entrailles de la terre et être pris d’admiration devant un spectacle inédit, inouï, inimaginable presque, à savoir l’existence de cristaux géants.
Gigantisme
Et quand on parle de gigantisme pour des cristaux, on veut dire par là que certains d’entre eux mesurent jusqu’à plus de 10 mètres parfois. Un décor unique, sensationnel, irréel, à plus de 300 mètres de profondeur.
Grotte
La grotte a été découverte en 1999 par deux frères qui creusaient un tunnel au fond de la mine. Le Mexique a quelque chose d’envoûtant, un de ces trucs qui n’existe nulle par ailleurs sur le globe.
Fantastique
Pour les amateurs de fantastique, d’ésotérisme, pour ceux qui aiment encore et toujours s’émerveiller devant le spectacle de la nature. Le Mexique et plus particulièrement, la région de Naïca vous propose de découvrir ses trésors enfouis.
Cavité
Il s'agit d'une cavité d'environ 35 mètres de long sur 20 mètres de large et 8 mètres de haut, bourrée de gigantesques cristaux.
Surréalistes
Cette grotte aux allures surréalistes renferme du plomb, du zinc et de l'argent, mais elle fascine les scientifiques pour ses extraordinaires cristaux de sélénite, une variété de gypse.
Naica
La mine Naica, exploitée pour le plomb, le zinc et l'argent, est située dans l'État du Chihuahua au Mexique, dans la ville de Saucilla.
 Les plus grands cristaux du monde.
Les plus grands cristaux du monde.
Mine
La mine de Naïca est une cavité souterraine qui contient de l’eau saturée en éléments chimiques, c’est-à-dire que l’eau ne parvient plus à dissoudre lesdits éléments.
Éléments
C’est alors que les éléments vont aller s’agglomérer les uns contre les autres en formant peu à peu des constructions dignes d’un film de science-fiction.
Dimensions
Pour que les cristaux se développent dans de telles dimensions, il faut naturellement un apport constant en éléments chimiques, une température et une pression constante.
Formés
Les cristaux de Naïca se sont formés dans les rivières souterraines qui ont été chauffées de manière régulière par le magma et cette croissance a duré plus de 10.000 ans, à raison d’un centimètre par siècle environ.
Eau
Lorsque l’eau de la mine commença à être pompée, leur développement s’est arrêté. D’une beauté fantastique, la grotte de Naïca fait sûrement partie des plus grandes découvertes archéologiques au monde.
Température
La température interne peut s’élever jusqu’à 60° et l’oxygène y est assez rare, ce qui rend l’exploration pas toujours aisée.
Caverne
Pensez également que le magma souterrain qui chauffe en continu cette galerie ne se situe qu’à 1,6 km de la surface… C’est la grotte, baptisée « Caverne aux Épées », qui est nettement plus accessible au public.
Admirer
Vous allez pouvoir admirer des cristaux qui atteignent plus de 11 mètres de longueur, dont le diamètre, parfois, peut faire près de 12 mètres et qui peuvent peser jusqu’à 50 tonnes. Entre réalité et rêverie, entre science et fiction, la grotte aux Cristaux de Naïca va vous transporter dans un monde à part.
Entrée
Comptez près de 20 minutes pour passer de l’entrée et jusqu’à la fameuse grotte : il faudra avoir un équipement spécialisé contenant de la glace pour réfrigérer votre corps et pour pouvoir respirer convenablement.
Sublime
L’entrée de la caverne est sublime et révèle toute sa splendeur : d’immenses cristaux qui balaient ou traversent la grotte de part en part.
Recouverts
Murs, plafonds et sols sont autant recouverts de ces gonflements cristallins et c’est pourquoi il faut marcher avec prudence. Notez que chaque visite dans la grotte se limite à 20 voire 30 minutes tout au plus.
Date de dernière mise à jour : 06/11/2024